Que connaissons-nous ? Comment connaissons-nous ? Quelle est la nature de la réalité ? Au point où nous sommes parvenus, il n'est pas facile de répondre à ces questions. Tout ce que nous pouvons dire de certain, c'est que pas plus les sens que la science ne donnent accès à la nature même du monde. Ils ne font que construire des modèles, des apparences dirons-nous, à partir d'une part de présupposés, et d'autre part de quelque chose qui existe bien là au-dehors mais dont la nature véritable échappe à nos outils de connaissance.
A partir de là deux attitudes sont possibles : ou bien considérer que la réalité est irrémédiablement inaccessible, auquel cas nous serions condamnés à empiler dans le désordre des couches de connaissances, souvent incompatibles entre elles, avec tous les risques que cela implique ; ou bien considérer que la nature réelle des choses peut être sinon atteinte du moins approchée, ce qui ouvrirait la porte à une science nouvelle à la fois plus puissante et moins dangereuse. Pour un certain nombre de raisons qui vont apparaître dans le cours de ce chapitre, notre préférence va résolument à cette seconde attitude.
La démarche est ambitieuse, voire démesurée. Mais dans les circonstances actuelles, il est plus que temps d'oser refaire de la métaphysique. Le mot est lâché. Il ne doit pas vous effrayer car c'est ce que vous avez fait depuis le début sans le savoir. Ce n'est somme toute pas trop douloureux, n'est-ce pas ?
Au cours de ce travail de reconstruction, vous serez peut-être surpris de ne trouver aucun développement sur la théorie des systèmes, la théorie de la complexité, la théorie du chaos, et autres structures dissipatives, qui font grand bruit depuis quelques temps, au point que certains veulent y voir la base d'un renouveau de la science, et la solution à tous les problèmes, ceux de l'homme comme ceux de la planète. La raison de cette omission est simplement que ces théories ne s'attaquent nullement aux problèmes de fond soulevés précédemment. Elles constituent au mieux des prothèses qui corrigent quelques imperfections et insuffisances du mécanisme, en aucun cas une nouvelle métaphysique. En revanche, intégrées dans un contexte différent, elles pourraient se révéler plus fécondes.
Revenons à notre problème : comment faire pour trouver des assises solides à la connaissance après avoir montré l'incontournable subjectivité des perceptions et la fragilité des fondements de la science ? En fait nous avons récolté en cours de route un certain nombre d'acquis, notamment : 1. qu'il faut se garder de faire jouer à l'espace-temps un rôle privilégié ; 2. que les expériences, pour être utiles, ne doivent pas concerner des cas pathologiques mais des situations parfaitement normales. Guidés par ces remarques, nous allons examiner quelques faits, l'un concernant la physique, l'autre la biologie, et le troisième la psychologie. Ces observations devraient nous aider à modifier le regard que nous portons sur le monde, et partant à trouver quelque chose de solide derrière toutes les apparences fragiles.
L'expérience de physique par laquelle nous commençons est connue sous le nom d'expérience des fentes d'Young. Diverses variantes existent, que nous allons décrire successivement pour bien comprendre le problème.
La première variante est représentée sur la figure 2.
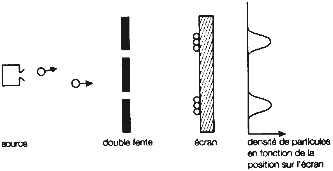
Des particules macroscopiques, comme des petits cailloux ou des billes de plomb, sont projetées une à une en direction d'un écran détecteur. Pour l'atteindre, elles doivent traverser une plaque percée de deux fentes. Le résultat obtenu après un certain temps de fonctionnement est une accumulation de particules sur l'écran en face de chaque fente précisément. La densité de particules en fonction de la position revêt cette forme à deux bosses que vous pouvez voir sur la figure à droite de l'écran.
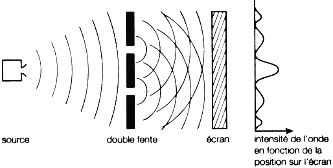
Dans une autre variante représentée sur la figure 3, la source de particules est remplacée par une source d'ondes monochromatiques, c'est-à-dire ayant toutes la même fréquence. Ce peuvent être des ondes d'eau, comme vous pouvez en voir lorsque vous frappez une étendue calme, ou de la lumière. Le résultat obtenu est très différent du cas précédent puisque vous voyez alterner régulièrement des régions de forte intensité et des régions d'intensité nulle. Cela est dû au fait qu'une onde passe simultanément à travers les deux fentes, et qu'ensuite les deux ondes résultantes interfèrent entre elles. " Interférer " veut dire que les ondes se superposent, de sorte que deux crêtes s'additionnent, et qu'une crête et un creux s'annulent comme le voyez sur la figure 4.
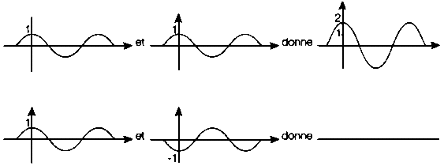
Dans une troisième variante, la source devient une source de particules quantiques (électrons, photons, neutrons, etc.), qui sont projetées une à une en direction de l'écran, comme le montre la figure 5.
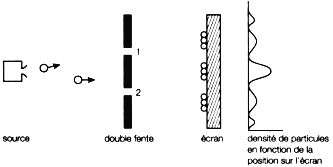
Le résultat obtenu cette fois est tout à fait surprenant puisqu'il prend la forme caractéristique des ondes et non pas des particules ! Les particules ayant été projetée une à une, la seule manière d'expliquer le phénomène est de dire, comme le fait la physique quantique, que chacune a un comportement d'onde, ce qui la conduit à passer à travers les deux fentes en même temps et à interférer avec elle-même. C'est la fameuse complémentarité onde-corpuscule du monde de l'infiniment petit (1).
Envisageons à présent la variante de l'expérience précédente décrite sur la figure 6, qui consiste simplement à interposer un obstacle derrière l'une des fentes.
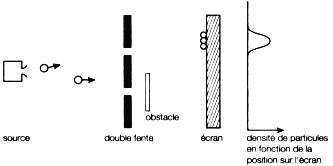
Le résultat obtenu est à nouveau en accord avec le bon sens puisqu'il prend la forme d'une simple bosse derrière la fente restée ouverte (il s'agit en fait d'une figure de diffraction, mais ne chipotons pas, cela ne change rien à notre démonstration).
La comparaison entre ces deux dernières expériences nous amène au coeur du problème. Il est logique de penser que l'état de la particule quantique est le même dans les deux cas tant qu'elle n'a pas atteint l'obstacle. D'une certaine manière, si l'on en croit la physique quantique, elle est une onde qui s'étale sur l'espace des deux fentes (plus précisément elle est étalée sur tout l'espace). Seulement voilà : si elle ne rencontre pas d'obstacle, elle conserve un comportement d'onde, jusqu'à l'écran où elle interfère avec elle-même ; par contre, si elle se heurte à l'obstacle, elle peut redevenir une particule et passer comme telle par le trou resté ouvert. Autrement dit, nous voici en présence d'une particule qui passe à travers une fente parce que d'une manière ou d'une autre elle " sait " que l'autre fente est fermée ! La question que soulèvent ces expérience est finalement celle-ci : comment une particule quantique peut-elle savoir qu'une des fentes est fermée, et tirer partie de cette information pour se manifester ailleurs, c'est-à-dire à l'autre fente ? Nous n'avons évidemment pas encore de réponse. Tout ce que suggèrent ces réflexions, c'est que cette matière qui nous constitue ressemble plus par certains aspects à de la pensée, de l'information, qu'à de l'étendue. Contentons-nous pour le moment de cette conclusion vague, sans chercher encore à préciser les termes.
Avant de passer à la biologie, profitons de l'occasion pour dire quelques mots de la physique quantique. A plusieurs reprises, nous nous sommes servis d'expériences inspirées de cette théorie (fentes d'Young et EPR) pour faire d'importantes réflexions sur la réalité. En revanche, nous n'avons jamais franchi le pas consistant à tirer de la théorie elle-même des conclusions sur la nature du réel. Certains par exemple n'hésitent pas à conclure à l'indéterminisme fondamental du monde à cause de l'indéterminisme de la théorie. D'autres se servent carrément de la physique quantique pour rendre compte des phénomènes paranormaux ou de l'origine de l'univers. Nous estimons que c'est aller trop loin. Pourquoi tant de prudence de notre part ? Pour le comprendre, il nous faut d'abord expliquer la notion de réalisme physique.
C'est très simple en vérité. Si vous êtes un biologiste qui travaille sur des gènes, alors la réalité de ces gènes ne fait pour vous aucun doute, même si vous ne les voyez qu'avec difficulté. Si vous êtes un physiciens travaillant sur des particules élémentaires, alors l'existence réelle de ces particules vous semble aller de soi, même si de savants montages expérimentaux sont requis pour les faire apparaître. Vous êtes tout au fond convaincus de la réalité de ces objets, quand bien même par précaution oratoire vous affirmeriez ne manipuler que des modèles. Le réalisme physique caractérise simplement cette attitude qui en science prétend décrire une réalité physique indépendante. C'est la plus naturelle qui soit, et toutes les théories se sont construites sur ce postulat. Toutes sauf une, la physique quantique, où la réalité se retrouve dissoute dans un formalisme très abstrait dont personne n'est en mesure d'expliquer à quoi il correspond dans le monde. On dit qu'il s'agit d'une théorie opérationnaliste parce que son but est non pas de décrire les objets et leurs propriétés, mais de résoudre des équations à partir de quelques postulats de base. Il s'avère en fin de compte que " ça marche ", mais nul ne sait pourquoi. En caricaturant à peine, nous pouvons dire que la physique quantique, comme tout modèle finalement, n'est rien d'autre qu'une collection de recettes servant à faire des calculs.
Parmi d'innombrables points prêtant à discussion, citons seulement le problème dit de la mesure. En physique quantique, l'évolution d'un système obéit à une équation, une équation parfaitement déterministe appelée équation de Schrödinger. Pour des raisons tout à fait mystérieuses, cette équation cesse d'être valable au moment d'une mesure, lorsque par exemple nous essayons de connaître la vitesse ou la position. Le système subit alors une transformation aléatoire et irréversible appelée réduction du paquet d'onde. Depuis la naissance de la théorie dans les années 20, personne n'a jamais fourni une explication satisfaisante de ce qui se passe à cet instant ! Et ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé. Certains physiciens pensent même que le problème est insoluble à cause de la nature même de la théorie. Il faut la prendre telle qu'elle est, s'en servir pour faire des calculs, et ne pas chercher ce qu'il y a derrière !
De nombreux autres points de la physique quantique sont aussi délicats. Nous n'en parlerons pas ici car cela nous entraînerait dans des discussions trop techniques. Nous invitons le lecteur intéressé à consulter le livre de Marceau Felden indiqué dans la bibliographie. Tous les arguments qu'il développe justifient notre prudence à l'égard de la physique quantique : nous pouvons nous servir de résultats expérimentaux mais nullement de son formalisme.
Pour clore cette petite réflexion sur la physique quantique, abordons la question de son rapport avec la relativité. Ces deux théories ont chacune à leur crédit maints succès. Pourtant toutes les tentatives faites à ce jour pour les réunir en une théorie unique se sont soldées par des échecs. La raison en est qu'elles sont totalement incompatibles. Plus précisément, on dit qu'elles sont incommensurables parce que les axiomes et les concepts de base de l'une ne peuvent être formulés dans le langage de l'autre. Ainsi la relativité est fondée sur la continuité, le déterminisme, la localité et le réalisme, tandis que l'univers quantique est discontinu (il existe par quantas, c'est-à-dire par petits paquets, d'où son nom), indéterminé, non-séparable et n'admet pas le réalisme. Une incompatibilité aussi grande entre deux théories par ailleurs parfaitement vérifiées chacune dans leur domaine, confirme notre conclusion du chapitre précédent, à savoir que la science est toujours une construction que nous plaquons sur le monde, et pas une description du monde. Et le fait que " ça marche " ne doit nullement être pris comme un gage de vérité.
Qui n'a pas été émerveillé par la splendeur d'une orchidée ? Mais qui sait que pour parvenir à un tel déploiement de beauté, il lui faut faire preuve d'un génie qu'on ne soupçonnerait guère chez un être prétendument inanimé. La première difficulté qu'elle a à surmonter vient du fait que sa graine ne possède aucune réserve alimentaire. Elle est donc incapable de germer lorsqu'elle est simplement mise en terre. Pour y parvenir, elle doit s'acoquiner avec un champignon qui lui donne à manger. Loin de constituer un parasitage, cette relation est une véritable symbiose, car dès que les racines de la plantule fonctionne, le champignon recueille son bénéfice : il reçoit des sucres en échange des minéraux qu'il fournit à la plante. Bien entendu, un système de contrôle permet à la relation de ne pas dégénérer. Le champignon n'est toléré que dans un domaine limité des racines, et s'il s'avise de pousser trop loin ses filaments, il se les fait tout bonnement phagocyter (2).
L'autre grande difficulté que doit surmonter l'orchidée est la fécondation. Si la plupart des fleurs sont hermaphrodites, l'autofécondation est généralement impossible car les étamines, souvent réduites à une seule, sont trop éloignées du pistil. En outre, elle ne fabrique pas ce nectar qui attire la plupart des insectes. Alors, pour réaliser le transport du pollen, les orchidées se sont lancées dans l'invention de dispositifs plus invraisemblables les uns que les autres. C'est ainsi par exemple que l'orchidée Ophrys a noué une relation très intime avec la guêpe Goryte. Le premier fait remarquable est que le mâle goryte naît environ un mois avant la femelle, ce qui élimine toute concurrence entre l'épouse légitime et la maîtresse. Le second fait remarquable est que la corolle de la fleur ressemble étrangement à l'insecte : forme, taille, couleur, reflets, pilosité, etc. Le troisième fait est lui carrément extraordinaire : la fleur sécrète une odeur analogue à la phéromone que la femelle synthétise pour attirer le mâle ! Celui-ci, en état de manque évident, se laisse abuser, et se livre sans retenue à une copulation avec la fleur, qui va parfois jusqu'à l'émission de sperme. Bien sûr il ne naîtra pas de guêpes de ces amours étranges. En revanche, en se trémoussant sur sa maîtresse, le mâle accrochera un peu de pollen, qu'il ira ensuite déposer sur une autre fleur avec laquelle il se livrera à de semblables ébats. (3)
La question qui se pose est simple : comment l'orchidée, qui est une plante dotée d'organes de perception plus que rudimentaires, a-t-elle fait pour ressembler à ce point à un insecte ? L'explication classique consiste à s'en remettre au hasard, qui, à force de mutations, aurait fini par créer cette extraordinaire ressemblance. Ce serait à l'extrême limite acceptable si ce cas était unique. Or loin d'être des exceptions, de telles co-évolutions constituent en fait le cas général. Nous ne résistons d'ailleurs pas à l'envie de vous raconter l'histoire encore plus folle de l'orchidée-marteau et de la guêpe thynnidée.
La scène se déroule en Australie, dans une région chaude et sèche où les incendies naturels sont fréquents, tellement fréquents que la vie s'y est adaptée : les sauterelles sont noires, les araignées couleur de cendre, les arbres se couvrent de plusieurs écorces pour se protéger, les fruits résistent au feu, les plantes vivent en grande partie sous la terre, suivies par de nombreux insectes, dont la guêpe thynnidée. La femelle a perdu ses ailes parce qu'il est impossible de travailler sous terre avec d'aussi encombrants appendices. Elle pond ses oeufs sur les racines d'un buisson parasité par des larves de scarabées dont se nourrissent ses propres larves. Voici résolu une partie de son problème. Reste celui de la fécondation. Pour qu'elle ait lieu, la guêpe femelle grimpe au sommet d'une haute fleur et émet sa phéromone. Le mâle, qui lui n'a pas perdu ses ailes, patrouille depuis déjà trois semaines, car comme dans l'exemple précédent, un décalage existe dans la venue au monde des deux sexes. Son état de privation le rend extrêmement sensible. Dès qu'il perçoit le signal odorant, il remonte la piste. Une fois en vue de l'objet de son désir, il descend en piqué, agrippe la femelle, et l'emporte dans les airs pour la féconder en plein vol. De temps en temps, il fait halte sur une fleur pour s'alimenter, et donner à la femelle l'unique repas de sa vie : il mange le pollen, le digère partiellement, et le restitue à la femelle. Ce travail accompli, il la dépose au pied d'un buisson, celui justement dont les racines sont parasitées par les larves d'un scarabée. Le cycle de vie de la guêpe est bouclé, et nous pouvons passer au second protagoniste de cette folle histoire.
L'orchidée-marteau, comme presque toutes les orchidées, a des problèmes de fécondation. Pour le résoudre, elle se sert de la petite thynnidée, profitant des trois semaines durant lesquelles le mâle est seul. La technique qu'emploie le mâle pour féconder la femelle est si spéciale que l'orchidée a du inventer un dispositif encore plus spécial. Pour commencer, elle a fabriqué un leurre de la guêpe femelle : tête brillante, corps rond et poilu, jusqu'à l'odeur qui est analogue à la phéromone synthétisée pour attirer le mâle. Mais si l'orchidée s'était contentée de disposer ce leurre comme précédemment dans la corolle, elle n'aurait rien gagné puisque cette guêpe atterrit pour redécoller aussitôt avec sa dulcinée. Au lieu de cela, elle l'a placé au bout d'un bras, long d'environ 6 cm, articulé sur une charnière élastique. Voici donc notre guêpe mâle qui pique sur le leurre et l'agrippe. Croyant tenir une femelle, il bat des ailes pour redécoller. Mais à cause du bras articulée, il se met à décrire un arc de cercle, et vient cogner une sorte d'enclume. La charnière élastique fait revenir le tout en arrière. Le mâle recommence, s'obstine, et vient à nouveau frapper l'enclume. Au bout d'un moment, sans doute lassé, il finit par lâcher prise et s'envole pour de bon.
S'il est déçu, l'orchidée elle a de quoi être satisfaite. En effet, l'enclume contient des sacs de pollen et un stigmate, c'est-à-dire un organe femelle. En se cognant dessus, l'insecte a accroché les sacs sur son dos. Et s'il en avait déjà provenant d'un autre orchidée-marteau, il les a déposés sur le stigmate, fécondant ainsi la fleur.
Il faut remarquer que la réalisation du marteau et de l'enclume sont proprement extraordinaires. L'orchidée ne s'est pas contentée d'imiter à la perfection la guêpe femelle. Elle a aussi " calculé " avec une grande précision tous les éléments du dispositif. En particulier, le marteau se bloque à une courte distance de l'enclume correspondant à l'épaisseur du thorax de l'insecte, car il doit juste frapper l'organe sexuel de la fleur, non être assommé ! (4)
De tels exploits, la Nature en fournit en abondance, tellement que l'explication en termes de mutations au hasard d'une matière inanimée ne saurait tenir. Nous sommes obligés d'admettre qu'il se passe " quelque chose " qui ressemble à un transfert d'information, à un niveau qui n'est pas celui de la matière que nous connaissons. Comment expliquer sinon que deux espèces appartenant à des règnes différents, l'un végétal l'autre animal, puissent se ressembler autant ? Quant à savoir précisément quelle est la nature de l'information qui passe, et quelle est la nature de l'être qui la traite, la question reste pour le moment en suspens.
De la biologie, passons à la psychologie animale. Une extraordinaire expérience a été réalisée dans les années 20 par Mac Dougall à Harvard. Il s'agissait d'observer comment des rats apprenaient à sortir d'un réservoir d'eau (5). Ils avaient pour ce faire le choix entre deux passages. L'un était éclairé, et les rats qui s'y engageaient recevaient une décharge électrique. L'autre était sombre et conduisait sans encombre vers la sortie. Le critère servant à mesurer la vitesse d'apprentissage était le nombre d'erreurs commises avant de choisir systématiquement le passage non éclairé. Ecoutons Mac Dougall :
" Certains rats étaient immergés plus de 330 fois avant d'apprendre à éviter le passage illuminé. Le processus d'apprentissage atteignait de manière soudaine un point critique. L'animal présentait pendant longtemps une aversion marquée pour le passage illuminée, hésitant fréquemment devant lui, faisant demi-tour ou l'empruntant avec une précipitation désespérée. Mais n'ayant pas saisi la simple relation de corrélation constante entre la lumière et la décharge, il continuait à emprunter le passage éclairé aussi souvent, ou presque aussi souvent, que l'autre. Enfin il en arrivait à un point de son entraînement où il se détournait définitivement et résolument de la lumière, cherchait le passage obscur et s'y engageait tranquillement. A ce stade aucun animal ne commettait plus l'erreur d'emprunter le passage illuminé, ou seulement en des occasions exceptionnelles. "
L'expérience porta sur 32 générations successives de rats et s'étendit sur 15 années. Une tendance très nette à apprendre plus vite fut constatée, comme le montre la figure 7.
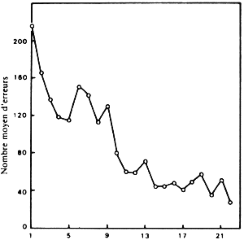
Le grand soin apporté à la réalisation de cette expérience ne laissait pas de prise à la critique. Tout au plus fut-il relevé que Mac Dougall avait négligé de tester systématiquement une lignée témoin de rats non entraînés. Les quelques mesures qu'il avait effectué de loin en loin révélaient pourtant des résultats encore plus étonnants : " Les groupes de contrôle dérivés de la souche originale non entraînée en 1926, 1927, 1930 et 1932, montraient une diminution du nombre moyen d'erreurs pour la période allant de 1927 à 1932 " (Mac Dougall). Autrement dit, les performances des lignées non entraînées s'amélioraient en même temps que celles des lignées entraînées ! Un aussi surprenant résultat incita à répéter l'expérience.
Crew de l'université d'Edimbourg observa 18 générations de rats sans mettre en évidence aucun changement dans la vitesse d'apprentissage. Voilà qui était très gênant. Puis l'on s'avisa que la souche de rats utilisée par Crew était la même que celle utilisée par Mac Dougall, et que les scores moyens obtenus au début de son expérience étaient semblables à ceux obtenus par les dernières générations dans l'expérience précédente. Un grand nombre de rats surent même sortir du réservoir sans jamais recevoir une seule décharge électrique (rappelons qu'au début de l'expérience de Mac Dougall des centaines de tentatives étaient nécessaires) ! C'était en fait comme s'il y avait continuité entre les deux expériences.
Les chercheurs ne s'en tinrent pas là. L'expérience fut reprise une troisième fois par Agar à Melbourne. Elle porta sur 54 générations successives et requit 20 années. La souche de rats n'était pas la même que dans les expériences précédentes. Une tendance marquée à l'amélioration des performances fut observée, dans la lignée entraînée comme dans la lignée témoin non entraînée.
Que démontrent ces expériences ? Qu'il existe une sorte d'hérédité qui n'est pas de nature génétique, c'est-à-dire qui n'a pas un support de matière. Car il faut bien admettre qu'il passe tout de même " quelque chose ", une sorte d'information, pour expliquer que la lignée non entraînée obtienne les mêmes scores que la lignée entraînée.
Une telle observation est loin de constituer une exception. A maintes reprises, les chercheurs ont observé sur des animaux d'étonnantes acquisitions d'aptitudes, qui ne pouvaient être dues ni à une transmission génétique, ni à un apprentissage culturel. Citons seulement le cas des singes de l'île japonaise de Koshima. Les scientifiques qui les étudiaient dans les années 50 avaient commencé à les nourrir avec des patates douces. Elles étaient déversées par chargements entiers sur la plage. Les singes adoraient les patates mais n'appréciaient guère de les recevoir souillées de sable. Cruel dilemme ! Il fut résolut par une jeune femelle de 18 mois prénommée Imo. Elle découvrit un jour qu'il suffisait de les plonger dans l'eau de mer pour qu'elles ressortent nettoyées. Elle apprit la technique à sa mère, à ses camarades de jeu, et bientôt toute la colonie sut préparer les patates douces. Jusque là rien de très extraordinaire. La suite de l'histoire est beaucoup plus intéressante, mais également moins connue parce que les chercheurs hésitèrent longtemps avant de publier ces observations qui allaient trop à l'encontre des idées reçues en biologie. Il apparut qu'au même moment, sur d'autres îles, des troupes de singes se mirent " spontanément " à faire usage de cette même technique qui leur était jusque là totalement inconnue ! Cet apprentissage se fit bien sûr sans qu'aucun lien physique ne fut établi entre les différentes colonies. (6)
Nous pourrions citer bien d'autres exemples. Chez l'homme aussi il ne fait pas de doute que de tels phénomènes existent. Ils sont malheureusement plus difficiles à isoler à cause du masque que constitue la culture. Nous pouvons tout de même supposer que l'actuelle facilité d'apprentissage de la bicyclette, de la conduite automobile, ou des jeux vidéos relèvent de processus de ce genre, par lesquels " quelque chose " se transmet qui n'est pas de nature matérielle, ni culturelle. C'est encore cela qui explique très certainement l'acquisition du langage par les enfants. Il y a en effet dans ce phénomène des aspects paradoxaux qui n'ont pas manqué de frapper les chercheurs. D'une part, la langue doit être apprise, et celle que les enfants apprennent est celle du milieu dans lequel ils vivent, ce qui fait pencher la balance du côté de la culture et semble devoir exclure des facteurs héréditaires. Mais en même temps, la facilité avec laquelle ils assimilent les riches et complexes structures sémantiques et grammaticales ne se conçoit qu'à condition de supposer des prédispositions héréditaires. Nous disons héréditaires et non pas génétiques car on imagine mal qu'il puisse exister un gène codant la grammaire du coréen et un autre celle du français ! Une hérédité de nature purement informationnelle, comme l'a mise en évidence les expériences de Mac Dougall et de ses suivants, permet d'expliquer cette facilité d'apprentissage de la langue maternelle par les petits d'hommes.
L'importance des trois exemples que nous venons de développer tient à ce qu'ils correspondent à des phénomènes très généraux et non pas à des cas pathologiques : l'expérience des fentes d'Young révèle un comportement profond de la matière ; les co-évolutions sont la règle dans la nature ; l'expérience des rats de Mac Dougall se généralise à tous les comportements d'apprentissage des êtres vivants. Ce caractère de généralité ainsi que la diversité des domaines couverts (physique, biologie, psychologie) contribuent à renforcer la conclusion à laquelle nous sommes parvenus dans chacun des cas, à savoir qu'il existe une dimension immatérielle derrière les phénomènes, une dimension qui est du type " pensée ", ou " information ", ou " idée ", ne nous arrêtons pas sur le terme pour l'instant.
Le problème qui se pose à présent est de trouver comment intégrer cette nouvelle dimension. La solution la plus simple consiste évidemment à procéder par empilement de couches successives : le monde-machine est conservé, et lui est surajouté un plan immatériel fait d'informations ou d'idées. Malgré son attrait, cette approche est la proie de sérieuses critiques. La première est le caractère par trop ad-hoc de la procédure, qui n'est pas sans rappeler l'accumulation des épicycles dans le modèle cosmologique de Ptolémée. Ce modèle situait la Terre au centre de l'univers, et tous les objets célestes sur des sphères en rotation circulaire et uniforme. Pour rendre compte de curieux mouvements de certaines planètes, Ptolémée imagina le système des épicycles : les planètes ne tournaient plus directement autour de la Terre, mais sur des cercles dont le centre était lui animé d'un mouvement circulaire et uniforme autour de la Terre. Chaque fois qu'une divergence apparaissait entre prédiction et observation, une nouvelle épicycle était rajoutée, tant et si bien que le modèle devint si compliqué que toute tentative d'apporter des corrections faisait surgir ailleurs de plus grandes erreurs. C'est le même risque auquel on s'expose si l'on se contente d'empiler une couche immatérielle sur une couche matérielle sans se soucier de leur cohérence. Le blocage survient en général très vite puisqu'il s'avère presque impossible d'établir de façon satisfaisante la jonction entre les différents plans. Comment en effet une substance immatérielle, c'est-à-dire qui n'est pas soumise aux contraintes de l'espace-temps, peut-elle s'unir à une substance matérielle ? Les réponses sont ou bien évasives, comme Sheldrake (7) qui ne dit jamais mot de la manière dont ses champs morphiques se relient à la matière, ou bien peu crédibles, comme Descartes qui enseigne que le siège de l'âme est la glande pinéale où elle est en contact avec les " esprits-animaux ".
L'approche consistant à empiler les modèles ne convenant pas, la seule possibilité qui reste est d'essayer de reconstruire une vision cohérente à base d'une substance unique. Mais quelle substance ? Une chose est sûre, elle ne saurait être de nature matérielle, parce qu'il s'avère impossible de ramener l'immatériel au matériel comme le prouvent les exemples qui précèdent, ainsi que l'incapacité de la science mécaniste à rendre compte de la pensée et de la conscience. En revanche, les réflexions du premier chapitre sur la perception nous inclinent à penser que le plan matériel peut lui se ramener au plan immatériel. Rappelons en effet que nous avons montré que des notions telles que la solidité, l'espace, ou le temps, sont en partie des constructions de notre esprit. Tout le travail de critique entrepris depuis le début de ce livre aboutit finalement à dégager d'une gangue d'apparences un petit noyau de certitude : il existe une substance de nature immatérielle, c'est-à-dire non soumise aux lois de l'espace-temps, une substance qui peut s'appeler idée, ou pensée, ou signification, ou forme, ou information, peu importe pour l'instant le terme.
Tant de chemin pour arriver simplement à énoncer cette banalité, penserez-vous ! Mais comme on dit : quand ça va sans dire, ça va encore mieux en le disant. Car maintenant, nous sommes parfaitement armés pour reconstruire une métaphysique. Nous allons pouvoir la poser sur un noyau dur de certitudes, et nous n'aurons plus à y revenir. Ces bases, d'une grande solidité, nous permettront d'avancer tranquillement et avec assurance dans la construction de cette science nouvelle que nous commençons à entrevoir.
Ces trois premiers chapitres nous ont conduit à faire un grand ménage dans nos têtes. D'un coup de balai énergique, nous avons éliminé grand nombre de nos croyances qui n'avaient pas de fondement solide. Mais tout de même, nous sommes encore là pour vous parler. C'est donc qu'il reste un petit " quelque chose ". En cherchant bien partout, nous avons fini par débusquer ce fameux " quelque chose ". L'inventaire est vite fait. Il tient en ces six points avec lesquels il va falloir nous débrouiller pour tout reconstruire :
Regardons maintenant de plus près ce que nous avons réussi à sauver du naufrage :
Les deux premiers points, à savoir que les idées et la conscience existent sont des certitudes absolues, les seules que nous puissions avoir sur le monde. Chacun de nous a des pensées, chacun de nous a une conscience. Plus précisément, nous n'avons conscience que de nos pensées. Par conséquent une métaphysique doit reposer sur ces bases et sur nulle autre. Remarquons que nous sommes loin du " je pense " cartésien, car nous nous contentons de poser l'existence de la pensée, sans préjuger en rien de l'existence d'un penseur derrière cette pensée.
Le troisième rescapé du naufrage est une simple conséquence des propositions précédentes : notre conscience témoigne de l'existence de la transformation. Elle est même d'une certaine manière un effet de la transformation. Mais nous anticipons.
Le quatrième point ne se situe pas sur un même plan de certitude que les précédents. Il s'agit de ce qu'on appelle en logique un postulat. Nous sommes obligés de poser l'interdépendance des idées pour ne pas tomber dans l'impasse solipsiste. Car nous ne pourrions évidemment construire de science si nous affirmions que rien n'existe en-dehors de notre pensée personnelle. Si cette proposition n'a qu'un statut de postulat et pas de certitude, c'est simplement qu'elle ne peut être prouvée de façon absolue. Impossible en effet de fournir des arguments définitifs réfutant le paradoxe suivant : tout n'est que rêve, et les rêves rêves de rêves.
Le fait que cette transformation a un sens, cinquième point, est aussi un postulat, mais d'une nature différente. D'une façon prosaïque, nous pouvons dire que cette proposition exprime simplement l'idée que l'univers n'est pas une gigantesque farce. La force de gravitation ne va pas s'interrompre demain parce qu'un dieu farceur en aura assez de jouer. Si nous voulons bâtir une physique, nous devons être assurés de la pérennité des lois métaphysiques. C'est seulement cela que garantit ce postulat.
Un dernier coup d'oeil sur l'inventaire permet de constater que nous n'avons besoin de rien d'autre. Le sixième point exprime donc l'idée selon laquelle la matière, l'espace et le temps n'ont pas d'existence en tant que tels, et se ramènent en fait à de l'immatériel. C'est ce que nous avons montré dans les premiers chapitres. Ajoutons que c'est également en accord avec les intuitions des hommes qui dans toutes les civilisations ont été appelés des Sages, conforme également avec ce que tout-un-chacun est en mesure d'expérimenter dans certains états modifiés de conscience. Nous aurons l'occasion d'y revenir.
Pour être valable, une métaphysique doit donc satisfaire à ces six règles, faute de quoi elle ne fournira ni connaissances valables, ni même la possibilité de bâtir une science. Munis de ces éléments, nous allons pouvoir pénétrer maintenant au coeur du Truc, ou, pour parler autrement, de la Weid.
1. John GRIBBIN, Le chat de Schrödinger, éditions du Rocher, 1984.
2. Jean-Pierre CUNY, L'aventure des plantes, Fixot, 1987.
3. Rémy CHAUVIN, La biologie de l'esprit, éditions du Rocher, 1985.
4. Jean-Pierre CUNY, L'aventure des plantes, Fixot, 1987.
5. expérience de Mac Dougall citée par Sheldrake dans Une nouvelle science de la vie, éditions du Rocher, 1981.
6. Michael TALBOT, Beyond the quantum, Bantam Books, 1987.
7. Rupert SHELDRAKE, Une nouvelle science de la vie, éditions du Rocher, 1981.
Champ morphique: champ d'information relié à un système matériel autonome dont il organise la structure ou l'activité. Dans la théorie de Rupert Sheldrake, toutes les formes, au sens large, sont régies par des champs morphiques: formes des molécules, des cristaux, des êtres vivants; " formes " comportementales; schémas mentaux; etc.
Métaphysique: science des principes premiers des choses. Il s'agit notamment de répondre à ces questions: quelle est la nature ultime de ce qui existe? quelle est la cause ultime du changement? Avec l'épistémologie, la métaphysique constitue le coeur de la réflexion philosophique. Elle donne leur assise à toutes les autres sciences qui tirent d'elle leurs certitudes et leur cohérence.