|
|
Bien que disponible gratuitement pour que tout le monde y ait accès sans barrière, ce document n'est pas pour autant sans valeur. Vous pouvez participer aux frais de création et de diffusion, en vous rendant à la page contact.
Que ce soit pour
des bâtiments monumentaux ou des habitation banales, il est devenu habituel
en architecture de séparer complètement la conception de la construction.
Cette séparation initialement temporelle, une activité précédant
l’autre, a fini par relever de personnes différentes exerçant
des métiers différents: architectes d’un côté chargés
de concevoir, maçons et charpentiers de l’autre chargés de construire.
Et pour rendre la réunification des tâches encore plus improbable,
est apparu plus récemment, c’est-à-dire au 19e siècle,
une phase intermédiaire de dimensionnement des structures relevant d’autres
personnes exerçant un nouveau métier, celui d’ingénieur
d’études.
Dans cette répartition
des tâches, la création est réservée à ceux
qui s’occupent de la conception, considérée comme l’activité
noble, le reste n’étant qu’exécution. On retrouve là l'antique
division entre arts mécaniques et arts libéraux, ces derniers
destinés aux hommes libres qui n'ont pas à exercer un métier.
De ce fait l’architecte est survalorisé. Il suffit de voir tous ces noms
qui s’étalent dans les médias dès qu’un projet de quelque
envergure est lancé. A contrario, qui saurait associer à des bâtiments
célèbres le nom de grands artisans constructeurs ou de grands
ingénieurs, à part Eiffel bien sûr?
Une des conséquences
négatives de cette séparation est que le travail de l’architecte
se déroule souvent hors de toute considération de culture et de
géographie. Bien entendu, dans les discours, il est indispensable, pour
ne pas dire politiquement correct, de faire référence à
l’intégration du projet au site et de son impact positif sur la vie des
gens. Mais les faits témoignent hélas que cela va rarement au-delà
des mots. Il n’est qu’à voir ce style dit ‘international’ qui envahit
toutes les grandes villes de la planète et même des sites touristiques
dans des zones encore préservées il y a peu.
Il va de soi que les contraintes
géologiques et climatiques doivent être prises en compte à
un moment ou un autre, particulièrement pour des projets importants.
Le plus souvent, c’est au niveau intermédiaire de calcul des structures.
L’architecte a éjaculé sa création (terme que je choisis
à dessein tant c’est une profession où les mâles dominent:
qui saurait citer le nom d’une architecte?), aux ingénieurs anonymes
de se débrouiller pour la rendre faisable. Pour une réalisation
culturellement, géographiquement et climatiquement intégrée
comme le centre culturel Jean-Marie Tjibaou (voir deuxième
partie), combien de dizaines voire de centaines d’aberrations comme la grande
bibliothèque de Paris?
Bien que regrettable une telle
dérive semble inéluctable lorsque le savoir s’éloigne trop
du faire. C’en est au point où en architecture, comme dans tant d’autres
domaines aujourd’hui, le faire-savoir a pris le pas sur le savoir-faire. Le
summum de la société du spectacle. La plupart de ces réalisations
n’ont en fait aucune considération pour l’homme ni pour la Nature,
sinon dans des discours creux, et forcément alambiqués pour masquer
leur vacuité, participants eux aussi du spectacle.
Je n’ai eu de cesse de le répéter,
un bâtiment pour moi doit prolonger le corps de l’homme et appartenir
au corps de Gaïa. Dans ces conditions, une approche architecturale qui
survalorise la conception et entérine définitivement la séparation
avec la construction ne saurait me convenir. Je préfèrerai si
c’est possible une approche qui les unit, conception et construction jaillissant
ensemble d’un même geste créateur.
Nous l’avons peut-être
oublié mais cette façon de faire est bien connue de chacun de
nous. Qui n’a pas construit des cabanes sans plan précis simplement en
assemblant des planches et des branches ramassées ici et là? De
nombreuses habitations ‘primitives’ sont encore ainsi faites, quoique témoignant
de plus d’élégance et de savoir-faire que nos cabanes d’enfants:

Points positifs:
on le voit sur l’image, la maison est bien un prolongement du corps, née
de ses mouvements, et elle s’intègre nécessairement au site. Point
négatif: on imagine mal comment étendre le procédé
à des structures couvrant non plus quelques dizaines de mètres
carrés mais des centaines, soumises donc à des contraintes supérieures
de plusieurs ordres de grandeur. Tel est maintenant mon but en forme de défi:
trouver au moins un procédé constructif permettant de réaliser
de grandes structures avec la même facilité et simplicité
gestuelle que l’on met en action pour réaliser une cabane, le terme ‘réaliser’
recouvrant ici à la fois la conception et la construction. Structures
qui aient évidemment une intégrité organique et ne consistent
pas en simple juxtaposition de petites cabanes.
Donc faire en sorte que savoir
et faire se rejoignent au point que l’art de l’ingénieur s’efface
complètement pour laisser place à des gestes simples réalisables
par tout un chacun. Que construire une maison devienne aussi facile et plaisant
que marcher, danser, faire des galipettes ou jouer au tennis, c’est selon le
goût de chacun.
Remarquons que pour apprendre
à faire tout ça nous n’avons rien à connaître de
l’organisation de notre corps, de ses muscles, de ses tendons, de ses nerfs,
de son cerveau. Nous n’avons pas davantage à connaître la théorie
de la gravitation ou la mécanique des fluides. Nous avons le savoir-faire
pour bouger notre corps et c’est en faisant que l’on apprend ce qu’il convient
de faire pour atteindre l’objectif souhaité. J’aimerais que l’on puisse
tous (du moins tous ceux que cela intéresse) acquérir de la même
manière le savoir-faire pour construire nos maisons, sans avoir besoin
d’accumuler des tonnes de savoir théorique. Pas seulement les petites
structures que sont les cabanes-cocons (voir deuxième
partie) mais aussi la grande structure que j’appelle les arbres et les
nuages (voir quatrième partie).
En guise d’apéritif, et aussi pour donner quelques arguments supplémentaires quant à l’intérêt de cette quête d’un nouveau procédé constructif, je propose quelques expériences.
Commençons
par une petite promenade dans un parc ou un jardin public. Sans nous laisser
distraire par les magnolias en fleurs ni les canards, concentrons-nous sur les
chemins qu’empruntent les gens. Vous noterez qu’ils diffèrent parfois
de ceux tracés par les paysagistes. Ces chemins de traverse se remarquent
à la disparition de l’herbe, au tassement de la terre, à l’érosion
du sol.
Nos manières d’habiter
un lieu devraient naître naturellement de nos interactions avec ledit
lieu et non pas être conçues sur plans pour de seules raisons logiques.
Par ‘naturellement’ je veux dire qu’en étant présent sur le lieu
même, nous captons un grand nombre de signaux, certains de manière
consciente d’autres subliminalement, qui forment à l’intérieur
de nous une gestalt sensorielle. Combinée à nos intentions, nous
projetons tout cela en retour au-dehors et cela conduit nos pas sur certains
chemins et nous éloigne d’autres. Les nouvelles perceptions nées
de ces déplacements modifient la gestalt et ainsi et de suite. Le processus
en général se stabilise, et c’est ainsi qu’apparaissent des chemins
naturels; ou parfois non, se mettant par exemple à osciller entre plusieurs
attracteurs (en fonction des saisons ou de ce qu’on a à faire: ainsi
en semaine on traverse le parc tout droit pour aller au travail tandis que le
week-end on s’y promène tranquillement en famille).
De la même manière
qu’une eau qui s’écoule sait trouver naturellement les chemins qui lui
conviennent le mieux en fonction de son débit, je pense qu’il y a pour
chacun des chemins qui naissent tout aussi ‘naturellement’ de son interaction
avec le lieu, de ce qu’on a à faire, de ce qu’on est à cet instant,
de la profondeur de la relation que l’on veut établir (ce n’est pas la
même chose évidemment de passer une heure à pique-niquer
que d’habiter plusieurs années au même endroit).
Cette évocation des
chemins suivis par l’eau me fait penser aux travaux de Viktor Schauberger. Entre
autres réalisations remarquables, il a construit dans les années
1920 en Autriche des canaux de transport de troncs par flottage particulièrement
efficaces. Différences avec les autres: un cheminement en méandres,
comme les torrents, et non pas rectiligne; une section ovoïde au lieu de
rectangulaire; des sortes de rails fixés à l’intérieur
pour donner à l’eau un mouvement spiralé. Résultats: des
canaux qui ne se dégradent pas rapidement suite aux chocs répétés
des troncs contre les bords; la possibilité d’en transporter en grandes
quantités et sur des distances beaucoup plus longues; la possibilité
même de flotter du bois plus dense que l’eau car il est remonté
en surface par la force des tourbillons. Des portions de ces canaux sont encore
visibles. ( http://ignoto.ru/proekt/00800/00200.htm
)
Cet exemple pour suggérer
que l’on n’a pas à tomber dans l’excès inverse de celui d’aujourd’hui
et se mettre à vénérer si servilement la Nature qu’elle
doive rester intouchée. L’homme est aussi Nature. Par son existence
il agit sur l’environnement au même titre que les termites, les éléphants
ou les arbres. Il faut seulement trouver la bonne mesure et la façon
correcte d’agir…
Revenons à
notre réflexion entre formes conceptualisées et formes nées
du geste. Le peintre Olivier Debré fait à ce propos une intéressante
remarque qui le conduit à suggérer une petite expérience
que nous ferons après:
"Le principe de la mesure
de l’espace par le système métrique manque de sensibilité.
Le Corbusier s’en étant rendu compte inventa le Modulor. En effet, l’analyse
par la sensibilité physique du corps ne peut pas aller au-delà
de trois (on peut déterminer un point dans l’espace, deux points, trois
points, mais à partir de quatre ou cinq points on est conduit à
décomposer: 2+2 pour 4, 3+2 pour 5 etc.). La division de l’espace en
décimales (système métrique), facile en arithmétique,
est trop complexe pour les sens, ceux de la compréhension corporelle
primaire. Il est nécessaire de passer par le raisonnement de l’intelligence.
On change de lobe cérébral comme on en change dans le passage
de l’image au mot. Notons que les mesures par le pied, le pouce et la multiplication
par 12 (12 se partage en 2 et 3, ce qui revient à un système primaire),
apparemment plus complexes, sont en réalité physiquement plus
simples. Les mesures doivent participer de la sensibilité. Il faut que
la mesure de l’espace fonctionne avec le cerveau droit. Et le système
métrique, tout comme le verbe, fonctionne avec le cerveau gauche. Pour
retrouver un rythme sensible, je suggère de tracer sur la page trois
points qui déterminent un rapport, et donc immédiatement une loi,
où par homothétie on retrouve le juste endroit du 3e, du 4e, du
5e, etc. Pour transmettre ces rapports, on peut les mesurer en centimètres.
Il faut prendre les proportions trouvées dans le rythme dessiné
et se conformer au principe homothétique. Par ce moyen, né de
la sensibilité de celui qui crée, se trouve une harmonie juste
plus sensible que le modulor et le système métrique." (espace
pensé, espace créé, le signe progressif, le cherche
midi éditeur 1999, p 134-5)
Passons à la pratique. Donnons-nous trois points alignés comme ceci:
![]()
À partir de
là, on sait construire mathématiquement une infinité de
points. Pour ce faire appelons L1 l’écart mesuré entre les deux
premiers points et L2 entre le deuxième et le troisième. Pour
le point suivant on pourrait prendre ![]() et plus généralement
et plus généralement ![]() .
Ou bien
.
Ou bien ![]() et plus généralement
et plus généralement ![]() ou encore
ou encore ![]() .
Ceci fait, on pourrait relier ces points par des portions de cercles, d’ellipses
ou de sinusoïdes pour obtenir au final de jolies courbes ondulantes.
.
Ceci fait, on pourrait relier ces points par des portions de cercles, d’ellipses
ou de sinusoïdes pour obtenir au final de jolies courbes ondulantes.
Au lieu de cela contentons-nous
de prendre un crayon, un feutre ou un pinceau et de tracer une courbe qui les
relie et se poursuit:
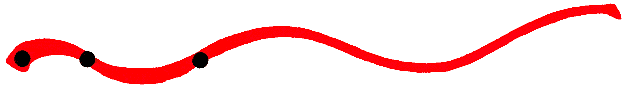
Là où ça devient intéressant, c’est lorsqu’il prend l’envie au crayon de se promener où bon lui semble. Par exemple:
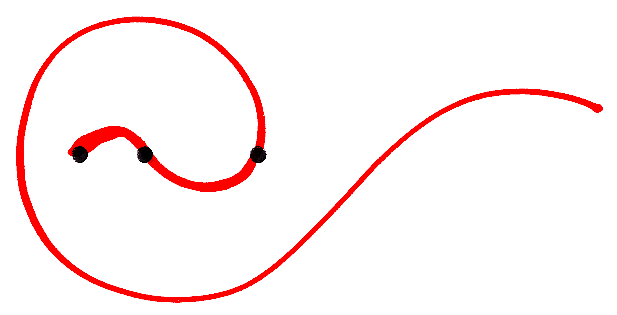
Chez la plupart d’entre nous l’imagination gestuelle est beaucoup plus riche, libre et féconde que l’imagination mathématique, qu’elle soit géométrique ou analytique. Cela fait du geste un outil pour engendrer des formes plus créatif et facile à manier. Ce n’est pas nouveau et d’ailleurs tous les architectes le savent bien. Il suffit de voir toutes les esquisses qu’ils tracent. Ce n’est que dans un second temps que ces tracés à main levée sont transformés en objets géométriques sur des plans et des maquettes. Ce à quoi j’aspire, c’est supprimer cette étape, que l’esquisse au lieu d’être sur le papier soit directement sur le terrain, et même, allant encore plus loin, que ce ne soit pas une esquisse mais directement le bâtiment qui soit construit de cette manière.
Continuons nos expériences.
Celles-ci sont à faire dehors dans un espace dégagé, plat
ou non (les résultats seront même plus significatifs s’il est un
peu accidenté).
Première expérience:
tracer au sol un cercle de quelques mètres de rayon à l’aide d’une
corde et de deux piquets. Plantez le premier piquet là où vous
voulez situer le centre et faites une trace dans la terre avec le second piquet
en tournant, corde bien tendue (si le sol est dur, marquez la circonférence
avec de l’herbe, des cailloux ou autres objets).
Deuxième expérience:
marquez le centre avec une pierre ou un piquet. Sans mesurer, éloignez-vous
de quelques pas à une distance que vous estimez convenable. Marchez en
tournant autour de ce centre en essayant de rester à peu près
à la même distance, ou variez-la si vous sentez que c’est mieux
ainsi. Marquez la circonférence à intervalles réguliers.
Épilogue: comparez.
Comprenez bien, il ne s’agit pas de savoir laquelle de ces formes est la plus
proche d’un cercle parfait. Il s’agit d’abord de ressentir laquelle vous plait
le plus et vous semble la mieux intégrée au site. Il s’agit aussi
de comparer ce que vous avez éprouvé en procédant d’une
manière et puis de l’autre. Laquelle vous semble convenir le mieux pour
inscrire votre présence dans ce lieu?
Un simple trait au sol ne fait pas une maison. Le défi est double: définir une surface de démarcation dans l’espace tridimensionnel qui enclose un volume d’air de plusieurs centaines de mètres cubes, et la matérialiser. Défi que quelques-uns ont perçu et tenté de résoudre.
 |
 |
|
Ushida-Findlay
partnership
|
|
Située au
Japon et construite en 1993, cette maison est le fruit d’une féconde
collaboration entre le japonais Eisaku Ushida et l’écossaise Kathryn
Findlay. La structure est en béton sur treillis métallique qui
autorise ces formes très organiques à la topologie complexe. Quand
je l’ai découverte dans le livre de James Wines l’architecture verte
je n’ai guère eu de doute sur la manière dont elle a été
conçue, par le geste sur le site même. Ce que confirme ce commentaire:
"Architecture, paysage
et sculpture ouvrent ici la voie à de nouvelles formes de spatialité,
traversées par des motifs récurrents tels que l’anneau de Moebius,
la spirale, modèle de croissance au sein de la nature qui préserve
les analogies internes, tout en rendant indissociables l’intérieur et
l’extérieur. Leurs formes organiques se déroulent dans un jeu
de torsions topologiques qui dynamisent l’espace et stimulent sa perception
multisensorielle (Truss Wall House). Leur architecture est la projection, sur
un espace physique, des désirs psychologiques de ses habitants (Soft
and Hairy House). Elle revendique la continuité entre le corps et l’espace.
Ici conscience spatiale et inconscient ont fusionné dans un même
champ cognitif où interfèrent intuition et modélisation
mathématique. La relation entre le corps comme espace et la perception
mentale de cet espace est au cœur de leur architecture. Ushida & Findlay
entendent réactiver cette perception psycho-physique de l’espace en insufflant
à leurs bâtiments des formes dérivées des mouvements
du corps humain. Fluidité, continuité, organicité et plasticité,
réversibilité des espaces, réverbération entre le
conscient et l’inconscient, doivent transformer l’architecture en matérialisation
d’un subconscient, non seulement individué, mais aussi global, cosmique.
Fascinés par "l’espace qui s’écoule" (Leon van Schaik),
les intérieurs de leurs architectures sont appréhendés
comme des "paysages habités", paysages psycho-sensoriels, tout
à la fois tactiles et mentaux, où le mobilier ou la lumière
y sont des composantes plastiques." (extrait de http://www.archilab.org/public/2000/catalog/ushida/ushidafr.htm
)
Même si cette forme naît
effectivement du geste, le problème ici demeure de la séparation
entre la conception et la construction. Cela tient au choix du procédé
constructif, le béton armé. À comparer avec la construction
d’une hutte de branchages montrée plus haut.
Si la mise en œuvre du geste créateur n’a guère été explorée pour engendrer des structures architecturales (je dis bien des ‘structures’ et pas seulement des ‘formes’ pour bien souligner la dimension matérielle) de grande ampleur (c’est-à-dire plus grande que la cabane ou la hutte), il est d’autres domaines où la recherche a été poussée très loin. Deux me viennent immédiatement à l’esprit: des pratiques corporelles de toutes sortes d’une part, incluant la danse, le sport, les arts martiaux, les arts du cirque, etc.; la peinture gestuelle d’autre part. Ces domaines se complètent dans la mesure où: les premières dessinent des formes dans l’espace tridimensionnel mais qui hélas ne durent pas, s’effaçant dès que le corps du pratiquant s’est déplacé et que la rémanence visuelle dans l’œil du spectateur s’est dissipée; tandis que les secondes ne permettent que de dessiner en deux dimensions mais en gardant trace dans la matière.
Nous intéressent ici les seules pratiques corporelles qui conduisent en quelque sorte à sculpter des formes dans l’air, que ce soit une finalité (comme dans le plongeon ou le patinage artistique) ou une conséquence (comme le geste de service au tennis dont la véritable finalité est de mettre la balle en jeu). La liste est longue:
- danses et
assimilées, plus ou moins artistiques et plus ou moins sportives: danses
primitives, danses traditionnelles, danses de salon, ballets classiques, danses
contemporaines, patinage artistique, etc.;
- arts du cirque: trapézistes,
équilibristes, sauteurs, contorsionnistes, etc.;
- sports individuels:
saut, plongeon, trampoline, ski acrobatique, gymnastique, gymnastique rythmique
et sportive, etc.;
- sports de balle: tennis,
volley, foot, rugby, basket, etc.;
- arts martiaux: escrime,
kung fu, taï chi chuan, judo, karaté, aïkido, etc.
La télévision,
notamment grâce au ralenti, permet bien de visualiser les formes aériennes
que sculptent ces corps en mouvement. Mais que faire de tout ça en architecture?
À vrai dire je vois mal comment transposer ces pratiques. Ce n’est pas
par total méconnaissance. J’ai beaucoup pratiqué, successivement:
le foot, le tennis, la natation, le iaïdo (l’art de dégainer le
sabre japonais), le taï chi. Ce qui ressort principalement de mes expériences
ainsi que de l’observation d’autres pratiques, c’est qu’il est possible d’entraîner
le corps à accomplir à la perfection pratiquement n’importe quel
geste.
Oui mais quel intérêt
pour construire une maison de savoir faire le saut périlleux arrière,
le triple axel ou le lobe lifté? Est-ce à dire a contrario que
si l’on ne maîtrise pas ce genre d’acrobaties l’on sera incapable de construire?
Bien sûr que non car la finalité n’est pas le geste lui-même
mais les formes sculptées dans l’air. Et pour ça, pas besoin de
gestes compliqués. Un exemple permettra de mieux comprendre. Prenons
une forme tridimensionnelle simple et bien connue, l’hémisphère.
Tenez un balai à bout de bras et faites lui décrire des grandes
courbes dans toutes les directions: l’extrémité libre dessine
dans l’air une forme quasi sphérique. Imaginez maintenant que vous deviez
dessiner cette surface avec votre corps en sautant sur un trampoline. Cela exigerait
une très grande maîtrise et il n’est pas sûr que le résultat
serait bien satisfaisant.
Donc il n’y a pas de rapport
direct entre la complexité du geste et la qualité de la forme
engendrée. Tous ces gestes très particuliers que l’on apprend
dans tel ou tel sport ne servent pratiquement à rien en dehors dudit
sport. Attention, cela n’enlève pas de leur intérêt: plaisir
de faire bouger son corps, de modeler sa musculature, plaisir de la compétition,
de la performance, etc. Mais aucun intérêt en revanche pour construire
une maison.
D’autant qu’il manque
une dimension qui est pour moi essentielle, la créativité. Toutes
ces pratiques visent à accomplir certains gestes le mieux possible. La
création a lieu presque toujours en amont, après quoi ce n’est
plus qu’une affaire d’entraînement pour atteindre la perfection? Par exemple
sauter à la perche, faire le coup droit et le revers au tennis, danser
dans un ballet, exécuter un numéro de trapèze, etc.
Les sports où l’on affronte
directement un adversaire comme les sports de balle réclament en théorie
plus de créativité puisqu’il faut continuellement adapter son
jeu à des circonstances changeantes. En pratique il n’y en a guère.
C’est pourquoi l’on s’ennuie tant. N’étaient les phénomènes
de foules et l’entretien de la flamme par un marketing puissant sous-tendu par
des enjeux financiers et/ou nationaux, beaucoup de ces sports seraient désertés
depuis longtemps.
Parfois l’on a la chance d’assister
à un coup de génie. La dénomination même suggère
bien le caractère exceptionnel dudit coup: le génie sort soudainement
de sa boîte, accomplit un miracle, et retourne s’enfermer aussitôt.
Alors l’attente reprend, ponctuée de "Oh!" de déception
qui entretiennent l’émotion jusqu’au prochain coup heureux, qui ne vient
pas toujours. Beaucoup s’en satisfont, moi pas. La préparation sportive
n’est pas qu’une affaire d’entraînement physique et de stratégie.
La créativité se cultive aussi et ne relève pas que du
génie ou du hasard. Quoique le hasard ait souvent son mot à dire.
Cela me rappelle une histoire, une de ces innombrables histoires sur les samouraïs
qui courent au Japon.
Il était une fois un
samouraï, expert en l’art du sabre comme il se doit ainsi qu’au jiu jitsu,
la lutte au corps à corps. À cause d’une attitude que, du haut
de sa morgue, il jugea offensant, il entreprit de donner une correction à
un paysan. Quoique conscient de son infériorité dans l’art de
la lutte, ce dernier n’était pas disposé à se laisser prendre
la vie sans combattre. Hélas sa résolution faiblissait sous les
coups qui pleuvaient dans un corps à corps bien inégal. Tandis
qu’il se débattait en tous sens pour se protéger, il sentit dans
sa main les parties génitales du samouraï. Encore suffisamment lucide
pour percevoir l’opportunité, il serra fort et tira violemment. Fin du
combat sur ce coup que le hasard lui mit entre les mains, et fin de l’histoire.
Sans transition passons à la peinture. Deux grands courants très éloignés l’un de l’autre culturellement, géographiquement et temporellement, explorent la dimension créatrice du geste en peinture: il s’agit en Chine de l’art traditionnel de la calligraphie et de la peinture au lavis, et chez nous du courant pictural né au 20e siècle de la peinture gestuelle, sous-catégorie de l’abstraction non géométrique ou informelle ou lyrique. Commençons par le second que la proximité rend probablement plus accessible.
Pour commencer quelques exemples de cet art qui me touche particulièrement:
 |
|
 |
|
 |
 |
 |
toutes
les oeuvres sont de zazen,
aquatinte sur zinc, 30x15 cm |
Mon intention n’étant pas de proposer un catalogue des œuvres les plus représentatives ni de composer un traité sur la peinture gestuelle, je me contenterai de quelques exemples et citations qui permettront de sentir en quoi consiste cette pratique artistique pas toujours bien connue, tout en gardant à l’esprit mon objectif, renouveler la pratique architecturale. Et pour commencer, histoire de prendre des repères, quelques noms d’artistes connus participant à ce mouvement: Hans Hartung, Georges Mathieu, Jackson Pollock, Pierre Soulages, Chu Teh-Chun, Fabienne Verdier…
Mathieu:
"Je ne peins pas vite
par manque de temps ou pour battre des records, mais simplement parce qu’il
ne fallait pas plus de temps pour faire ce que j’avais à faire et qu’au
contraire un temps plus long, ralentissant les gestes, introduisant des doutes,
aurait porté atteinte à la cruauté des formes, à
l’unité de l’œuvre." (revue Azart n°18, p 53)
"Seule la rapidité
d’exécution permet de saisir et d’exprimer ce qui monte des profondeurs
de l’être sans que la réflexion et l’intervention du rationnel
retiennent ou modifient son émergence spontanée." (cité
par Gottlieb Leinz dans la peinture au 20e siècle, Belfond 1990,
p 261)
"C’est à l’artiste
d’imposer au monde un nouvel art de vivre en rendant à ce monde d’abord
le désir de vivre au plein sens du terme, c’est-à-dire: participer.
Faire accéder l’homme au processus créateur, alimenter la vie
cosmique et sociale…" (Azart n°18, p 53)
Bazaine:
"Dans ses notes sur
la peinture d’aujourd’hui de 1948, Bazaine explique que l’art abstrait doit
représenter l’unité de l’homme et du monde extérieur. Il
faut donc élaborer des "grands signes essentiels de l’univers"."
(Gottlieb Lienz, p 263)
Hartung:
"Même dans ses dernières
œuvres, Hartung reste préoccupé de "vaincre la pesanteur
et de manifester des forces … par la force, la rapidité, la rigueur et
la souplesse du trait". Il cherche à pénétrer au plus
profond des choses, "dans les tensions atmosphériques et cosmiques,
dans les énergies et les rayonnements qui dominent l’univers"."
(Gottlieb Lienz, p 260)
Chu Teh-Chun
"La création
procède de la pure spontanéité: elle consiste, selon la
maxime taoïste, à laisser jaillir l’émotion intérieure.
Il en résulte sur mes toiles un langage pictural où la couleur
et le graphisme, sans jamais coïncider, concourent au même but: éveiller
la lumière, les formes et le mouvement." (Azart n°8, p 49)
"L’abstrait est resté
pour moi un langage essentiel qui se transforme et s’enrichit indéfiniment
pour communiquer l’expérience et la contemplation vécues."
(Azart n°21, p 38)
Notons dans ces derniers propos une précieuse indication pour apprécier ces œuvres: simplement contempler et se laisser traverser par les sensations de lumière, de formes et de mouvement. C’est tout. Vivre l’instant de cette réalité nouvelle à laquelle nous fait accéder le peintre comme il l’a lui-même vécue en la créant. Surtout ne pas chercher à reconnaître quoi que ce soit. J’observe souvent ce travers chez de nombreuses personnes qui découvrent des peintures abstraites: forcer des formes familières à émerger, là un arbre, ici une silhouette. C’est l’erreur qui fait perdre le sens en croyant le trouver. C’est passer à côté de l’essentiel qui me semble être l’invention par l’artiste de "grands signes essentiels de l’univers" pour reprendre la belle expression de Bazaine. Et Hartung d’ajouter: "Un jour, on trouvera cette écriture immédiate plus normale que la peinture figurative, tout comme nous jugeons notre alphabet, qui est abstrait et offre des possibilités illimitées, plus adéquat que l’écriture figurative des chinois. Mais cette chose qui vient de naître, le fait de s’exprimer en créant sans faire le détour par la nature, va certainement rester une fois pour toutes." (cité par Gottlieb Leinz p 260) Je crois qu’il méconnaît la force des signes chinois mais pour le reste je suis d’accord.
En préalable,
pour ceux qui croiraient qu’une civilisation chinoise bien normée n’a
pu engendrer qu’une peinture académique figée se complaisant dans
la copie des maîtres et la répétitions des sujets, je tiens
à citer cet exemple hors normes:
"Au début du 9e
siècle, Wang Mo se fit le spécialiste de l’encre éclaboussée,
réalisant, en état d’ivresse, nombre de paysages. Il lui arrivait
aussi de peindre avec ses cheveux imbibés d’encre qu’il projetait sur
la soie. On raconte qu’il travaillait en riant ou en chantant, étalait
son encre à coups de pieds, la frottait avec ses mains, la balayait avec
son pinceau, obtenant les nuances de l’encre tantôt épaisse tantôt
pâle. Ces excès représentaient au yeux de certains un péril
pour la peinture. Ces expérimentations furent à l’origine de l’école
dite "de peinture sans contraintes", le Yi-P’in, qui se développa
au Sechouan à Chengdu aux 9e et 10e siècles. Le représentant
de cette école fut le peintre Che-K’o à qui on attribue le célèbre
patriarche et tigre, œuvre où les taches d’encre bondissent et
trahissent la spontanéité du mouvement. Son style s’apparente
à la cursive folle." (Tuan Keh Ming et Peng Chang Ming, l’esprit
de l’encre, You Feng libraire éditeur 2003, p 28)
 |
Che
K’o patriarche et tigre dans l’esprit de l’encre You Feng libraire éditeur 2003, p 27 |
Presque de la peinture
à la Pollock dix siècles avant Pollock. Je dis ‘presque’ car même
s’ils ont poussé l’expérimentation très loin, il est un
pas que les chinois n’ont jamais franchi, celui de la pure abstraction. Remarquons
que c’est en arrivant en France que des peintres chinois comme Zao Wou Ki ou
Chu Teh Chun ont découvert l’abstraction. Ils en ont été
bouleversés au point de renouveler complètement leur pratique,
retrouvant en le réinventant le geste créateur de la peinture
traditionnelle chinoise. Ce qui fait dire à Chu Teh Chun, qui vit pourtant
en France depuis 1955: "Les trésors cachés de la civilisation
de mes ancêtres sont intarissables. Avec le temps je me sens de plus en
plus chinois. Sans hésitation, je suis à jamais chinois."
(Azart n°21 p 40)
Les chinois n’ont pas inventé
l’abstraction mais ils ont beaucoup flirté avec: "Toute personne
qui parle de la ressemblance est bonne à renvoyer chez les parents."
(Sou Che, 1036-1101).
Qu’est-ce que les peintres
chinois cherchent à représenter alors?
"Très tôt
apparaît l’idée que c’est le souffle, l’esprit, qui doivent être
recherchés au-delà de la pure apparence extérieure. Le
spectacle de la nature est perçu et ressenti sur un mode spirituel. Zong
Bing (375-443) dans introduction à la peinture de paysage l’avait
souligné. À l’époque Tang, Wang Wei dans la dissertation
sur la peinture s’était aussi efforcé de montrer que l’art
de peindre ne saurait se limiter à tracer des limites, des frontières,
des contours aux formes et il rappelait que: "Ce qui est essentiel à
la forme, c’est le souffle qui par son mouvement l’informe, et ce qui, de par
son dynamisme spirituel, met en branle la mutation, c’est l’esprit. L’énergie
spirituelle reste invisible, aussi ce qu’elle habite paraît immobile."
Wang Wei avait rappelé également que dans la conception d’un paysage,
l’idée est primordiale: "En peignant un tableau de paysage, le peintre
doit avoir son pinceau guidé par le i (idée, désir,
intention, conscience, juste vision)." Sous-tendant l’acte de peindre,
on trouve l’idée que cet art est capable de révéler le
principe des êtres et des choses et ne faire plus qu’un avec le Tao."
(Tuan Keh Ming et Peng Chang Ming, l’esprit de l’encre, You Feng libraire
éditeur 2003, p 14)
Ce qui compte donc c’est représenter
le souffle qui anime toutes choses. Le peintre y parvient en se mettant
en contact avec son propre souffle intérieur. Ainsi il peut mettre
en acte le processus par quoi la Nature elle-même crée. C’est cette
faculté de représenter dans une forme sur le papier la rencontre
entre l’esprit du peintre avec les forces morphogénétiques de
la Nature qui m’intéresse ici pour trouver une réponse au défi
d’une nouvelle pratique architecturale. Et les chinois ont plus de 25 siècles
de recul alors que nos peintres abstraits n’en ont guère plus d’un, largement
de quoi théoriser leur pratique.
L’ennui est que les traités chinois (par exemple le Wang Wei cité plus haut ou, de Shitao, les propos sur la peinture du moine citrouille amère) ne sont pas conçus pour des occidentaux. Loin d’être didactiques, ils nous perdent dans des formules lapidaires, des pensées circulaires qui reviennent toujours sur le même objet, l’absence d’explication des concepts essentiels qui pour un chinois vont de soi. Comme notre sujet reste l’architecture et pas la peinture, on me pardonnera si je court-circuite ces traités, préférant me laisser guider par quelqu’un plus proche de nous qui connaît bien le sujet et a accompli le travail d’explication. Un des meilleurs à ma connaissance est Jean-François Billeter dans son art chinois de l’écriture (Skira 1989). J’en tire ces quelques extraits qui me semblent dire l’essentiel sur l’art du peintre-calligraphe, les deux étant indissociables en Chine.
"… nous nous apercevons que la distinction entre le corps et l’esprit, qui a la vie si dure dans nos idées, est problématique et que d’autres distinctions sont à bien des égards plus pertinentes, notamment celle du "corps propre" et du "corps objet". Le "corps propre" est notre corps, celui dont nous ressentons directement et de manière permanente la présence, tandis que le "corps objet" est le corps de l’autre, celui que nous percevons du dehors comme un objet et dont nous avons, entre autres, une représentation visuelle. N’étant pas des réalités du même ordre, le corps propre et le corps objet ne peuvent être définis de manière analogue. Comme le corps propre ne nous est pas extérieur, nous ne pouvons le classer parmi les objets comme le second. L’observation nous invite à le considérer plutôt comme une activité: il est l’activité que chacun de nous perçoit en lui-même de façon continue, même lorsqu’il n’y prête pas attention… Cette activité sensible à elle-même et qui se perçoit elle-même, nous l’appellerons "l’activité propre"." (136-7)
"Les chinois
ont tenu l’homme pour un être qui n’entre dans la pleine jouissance de
lui-même qu’après avoir perfectionné l’organisation qu’il
reçoit de la nature. L’originalité des conceptions chinoises se
manifeste surtout sur un point: ce perfectionnement de soi est indistinctement
un perfectionnement du corps et de l’esprit. À la différence de
la pensée occidentale, qui a généralement considéré
le corps et l’esprit comme deux entités distinctes, la pensée
chinoise les a plutôt conçus comme deux aspects de l’activité
propre. L’un et l’autre participant d’une même activité, leur opposition
était toute relative. Le second point remarquable était que cette
activité était tenue pour perfectible. L’homme peut affiner, aviver,
unifier son activité propre, et, ce faisant, modifier simultanément
le fonctionnement de son corps et celui de son esprit. Il peut unifier son activité
propre au point d’abolir la distinction entre l’un et l’autre. C’est en réalisant
ces formes supérieures d’activité qu’il parvient au plein épanouissement
de ses facultés et au parachèvement de sa nature. Les chinois
ont conçu les arts comme des disciplines visant à réaliser
ces formes supérieures d’activité qu’ils tenaient pour le souverain
bien. Ils les ont considérés comme autant de moyens de réaliser
diverses formes d’activité parfaite.
Pour le lecteur qui tient à
raisonner en toute rigueur, notons qu’activité n’est pas action.
Dire que les chinois ont eu pour idéal une certaine idée d’activité
parfaite ne signifie pas qu’ils aient valorisé l’action. Telles que nous
les entendons ici, les notions d’activité et d’action s’opposent en effet
sur plusieurs points: 1) l’activité (il s’agit de notre activité
propre) est intérieure avant de se manifester à l’extérieur
tandis que l’action nous est toujours extérieure; 2) l’activité
est permanente tandis que l’action est intermittente; 3) l’activité n’a
pas de but extérieur à elle-même alors que l’action a nécessairement
un but extérieur. Ces oppositions font toutes apparaître l’activité
comme quelque chose de plus fondamental que l’action. Tel est bien le point
de vue des chinois: ils ont toujours regardé l’activité propre
de l’homme comme le phénomène primordial et son action extérieure
comme un phénomène secondaire. L’homme supérieur était
à leurs yeux celui qui avait parfaitement réglé son activité
propre et possédait de ce fait le pouvoir d’agir avec la plus grande
économie quand les circonstances l’exigeaient. Son activité n’avait
pas l’action pour fin mais rendait son action suprêmement efficace lorsqu’il
lui fallait agir. Le goût des chinois pour le "non-agir" a au
fond toujours été un goût pour l’activité supérieurement
réglée, qui est à elle-même sa propre fin, et pour
l’efficacité pratique qui en résulte par surcroît
quand l’occasion l’exige." (269)
"Dans la réalité chinoise traditionnelle, la réalité surgit d’un fond indifférencié. Elle se manifeste d’abord sous une forme embryonnaire, prend corps et se réalise enfin tout à fait; une fois réalisée, elle est condamnée à disparaître et à être remplacée par une réalité nouvelle, surgie en son sein dans l’entretemps. Ce cycle s’accomplit sur place, dans un espace sans limites extérieures… Ce qui frappe dans cette vision des choses, c’est que la forme précède l’existence pleinement réalisée. Elle est un stade intermédiaire entre l’indifférenciation dont tout procède et l’être achevé. Elle est le moment transitoire où, dans l’énergie indifférenciée, des courants d’énergie (des souffles) se forment, se combinent en figure, et constituent la réalité nouvelle à l’état naissant. Il est caractéristique qu’on ne dise pas en chinois qu’une forme, une figure ou un signe ont une signification mais qu’ils ont une intention." (248)
"L’enchantement que procure la grande peinture ne tient pas seulement à ce qu’elle offre une vision renouvelée du monde qui nous entoure, mais qu’elle nous fait deviner la part que nous avons dans la genèse de ce monde: elle nous fait sentir que la projection de notre activité propre sous-tend en permanence notre rapport au visible, que nous sommes donc virtuellement maîtres de ce rapport et que nous pourrions, si nous le voulions, reprendre nous aussi l’exploration de nous-mêmes et du monde que nous avons interrompue dans notre enfance." (143-4)
"Le dessin n’est d’abord que la trace accidentelle des mouvements du corps. Comme l’observe Henri Michaux, "Les cercles parfaits des dessinateurs et des géomètres n’intéressent pas l’enfant. Les cercles imparfaits de l’enfant n’intéressent pas l’adulte. Il les appelle des gribouillis, n’y voit pas le principal, l’élan, le geste, le parcours, la découverte, la reproduction exaltante de l’événement circulaire où une main encore faible, inexpérimentée, s’affermit." C’est qu’au début, "plus que les traces, le geste compte, le faire du cercle". Pour l’enfant, le faire et la forme qui en résulte ne font qu’un. Il se désintéresse de la forme dès que l’activité cesse. Un jour, pourtant, il lui vient à l’idée de considérer pour elle-même la forme dessinée, le plus souvent parce qu’un adulte lui demande ce qu’elle représente. Il projette alors dans le dessin sa réalité corporelle, il en fait par l’imagination un objet réel: c’est un soleil, répond-il à l’adulte, c’est du café, c’est un escargot. "Les plus imprécises approximations ne gênent pas l’enfant, écrit Michaux. Ce qui compte c’est le rapprochement. Ce rapprochement, trouvé et retrouvé vient ouvrir de façon claire une porte qui en ouvrira quantité d’autres. Large porte de la connivence."" (141)
L’intérêt
de la peinture est qu’elle est une trace matérielle visible du geste
créateur. Sa limite est de rester cantonnée dans le plan. La sculpture
n’a pas cette limite puisqu’elle opère directement dans l’espace tridimensionnel.
Sauf que je ne vois pas dans cette pratique l’expression d’un geste créateur
au sens précédent. Pour être juste je dois préciser
que je connais beaucoup moins ce domaine que la peinture. En tout cas dans le
peu que je connais je ne retrouve pas ce souffle qui anime le geste qui
engendre des œuvres telles que celles de Pollock ou de Chu Teh Chun. Chez Giacometti
peut-être. Mais il dessinait beaucoup avant de sculpter. Retour donc dans
le plan. Quant à ceux qui ne dessinent pas, la matière qu’ils
travaillent semble offrir trop de résistances par rapport à la
fluidité de la peinture, retenant le geste, l’empêchant de fulgurer.
En fin de compte, ce qui me
plait tant dans la peinture gestuelle par rapport au présent travail
sur la pratique architecturale, c’est la fulgurance créatrice qui l’anime
et que je ne retrouve guère ailleurs. Je ne prétends pas bien
sûr que ce soit la seule forme de création valable. Je dis juste
que pour faire un bâtiment qui soit une extension du corps de l’homme
appartenant au corps de Gaïa, cette façon de faire me semble la
plus appropriée: le geste crée automatiquement une œuvre architecturale
qui prolonge l’homme et exprime son intention; ce geste se déroulant
en un endroit précis de la Terre dans un état qui nous relie à
des forces créatrices profondes, l’œuvre architecturale prend aussi automatiquement
place au cœur de Gaïa. J’y reviendrai.
Reste à trouver le moyen
de matérialiser ces surfaces de démarcation nées du geste.
En fait il se pourrait bien que ce ne soit qu’un problème secondaire,
exactement comme en peinture:
"Le premier problème
de la création picturale n’est donc ni technique ni même esthétique:
c’est un problème éthique et philosophique. Peindre est difficile
avant de peindre. Le premier travail du peintre est de développer en
lui cette source intérieure du cœur … l’exécution matérielle
de la peinture ne pose alors plus de problèmes, elle n’est que la conséquence
naturelle et aisée de cette vision spirituelle qui la précède;
comme le dit un autre auteur: "les objets ne sont pas saisis par la perception
des sens: ils sont enclos dans l’habitacle de l’âme; c’est pourquoi la
main ne fait que répondre à ce que le peintre a saisi dans son
cœur"; ou encore: "Zhang ne faisait que transmettre à sa main
ce qu’il avait saisi dans son cœur, et l’exécution s’ensuivait d’elle-même
tout naturellement sans même qu’il en eût conscience"."
(Pierre Ryckmans dans ses commentaires aux propos sur la peinture du moine
Citrouille-amère, Hermann 1984, note 9 p 20)
Voilà pourquoi j’insiste
tant sur la dimension philosophique de la question et suis passé beaucoup
plus vite sur les pratiques gestuelles elles-mêmes. Une fois le fond éclairci,
les solutions techniques devraient venir d’elles-mêmes. Nous n’en sommes
pas tout à fait là. Il y a encore quelques questions qui méritent
réflexion.
Shitao dit ceci:
"Par le moyen de l’Unique Trait de Pinceau, l’homme peut restituer en miniature
une entité plus grande sans rien en perdre: du moment que l’esprit s’en
forme d’abord une vision claire, le pinceau ira jusqu’à la racine des
choses."
On trouve la même idée
dans le tableau des manœuvres du pinceau: "On échoue lorsque
le pinceau devance l’intention, on réussit lorsque l’intention mène
le pinceau."
Pollock quant à lui
semble dire le contraire: "Quand je suis dans mon tableau, je ne suis pas
conscient de ce que je fais. C’est seulement après un espace de temps
de prise de conscience que je vois ce que j’ai voulu faire."
Fabienne Verdier va aussi dans
ce sens: "Je peins mon vide de tableau comme une parcelle d’univers prête
à recevoir. Et je me laisse emporter à observer sa profondeur
comme si c’était ma véritable demeure. Je me perds dans son illimité,
je plonge dans ses tourbillons, ses remous, ses secousses de vents sans savoir
où je vais. J’ignore ce que je contemple, je ne vois pas. Je suis dans
le non-visible, et pourtant je laisse advenir au bout du pinceau ce qui cherche
à naître." (Charles Juliet, entretien avec Fabienne Verdier,
Albin Michel 2007, p 67)
Pour alimenter le
débat, ou achever de l’embrouiller, voici un tout autre argument:
"Selon le Dr Charles Garfield,
ex-chercheur à la NASA et président en exercice du performance
science institute de Berkeley, les soviétiques ont accordé
une grande attention à ce rapport entre imagerie mentale et performance
physique. Une de leurs enquêtes porta sur une équipe d’athlètes
de niveau international répartie en quatre groupes. Le 1er groupe passa
la totalité de son temps d’entraînement à simplement s’entraîner.
Le 2ème n’y consacra que 75% de ce même temps, le quart du reste
étant utilisé pour visualiser leurs mouvements et l’objectif qu’ils
comptaient atteindre. Le 3ème fit part égale entre entraînement
et visualisation. Le dernier groupe, enfin, privilégia la visualisation,
ne consacrant qu’un quart de son temps à l’entraînement classique.
Contre toute attente, ce fut le 4ème groupe qui, aux jeux olympiques
d’hiver de Lake Placid effectua les meilleures performances, suivi, dans cet
ordre, par les groupes 3, 2 et 1. Le psychologue australien Alan Richardson
a obtenu des résultats similaires avec des basketteurs. Après
avoir testé leur aptitude au lancer franc, il les répartit en
trois groupes de force égale. Au 1er, il demanda de passer 20 minutes
par jour à travailler cet aspect particulier du jeu, au second, de ne
pas s’entraîner, et au 3ème, de consacrer ces mêmes 20 mn
à s’imaginer expédiant la balle au panier à tous les coups.
Comme on pouvait s’y attendre, le 2ème groupe ne fit aucun progrès.
Les performances du 1er enregistrèrent une hausse de 24%. Mais le plus
surprenant fut que le 3ème groupe, par le seul pouvoir de la visualisation,
se hissa presque au niveau de celui qui s’était physiquement entraîné
avec 23% de paniers réussis supplémentaires." (Michael Talbot,
l’univers est un hologramme, pocket, p 144)
Que tirer de tout
ça? L’œuvre est-elle créée avant d’être matérialisée
ou est-elle découverte à mesure qu’elle se fait? Je ne pratique
pas la peinture mais je vis avec une peintre et je la vois faire. Et puis j’ai
beaucoup fait de création musicale sous forme d’improvisations au saxophone.
Il est clair pour moi que l’œuvre se laisse découvrir à mesure
qu’elle se crée sous les doigts.
Mais il est tout aussi clair
que sans préparation, prenant pour moi la forme de travail sur partitions
classiques, rien de bon ne sort, sinon des tics, des traits convenus ou des
flots de notes aléatoires qui n’ont aucun sens. Dans les années
60 beaucoup de musiciens ont cru que jouer du free-jazz (ma musique préférée)
consistait à faire n’importe quoi, qu’il n’y avait rien à connaître
de la musique et qu’aucune maîtrise de l’instrument n’était requise.
Objectif atteint: le résultat était vraiment n’importe quoi! Leurs
noms sont oubliés, leurs musiques aussi. Mais on peut toujours écouter
et réécouter les derniers disques de John Coltrane à la
musique complètement libérée parce que lui-même était
enfin complètement libre (interstellar spaces et stellar regions
chez Impulse).
Toute création matérielle
exprime une intention. Mais cette intention ne consiste pas nécessairement
en une visualisation préalable de l’œuvre achevée. C’est davantage
une préparation intérieure, une exploration de ses propres attentes
traduites éventuellement en sensations visuelles et/ou kinesthésiques.
Au moment de l’action, la projection de ces attentes auxquelles on a déjà
donné forme importe tout autant que la disponibilité aux surprises.
Car à cet instant l’univers n’est plus le même qu’au moment où
l’on travaillait en imagination, et aussi l’on est soi-même différent.
Si l’on se contente de reproduire une image intérieure créée
antérieurement sans être ouvert à ces changements, l’œuvre
ne sera pas parfaitement accordée à soi ni à l’univers.
Donc le geste créateur se prépare: par des exercices mentaux de
visualisation, des exercices physiques d’acquisition d’un geste, et des exercices
de méditation pour se mettre à l’écoute de soi-même
et de l’univers. Mais au moment d’agir, on oublie tout pour que le geste créateur
jaillisse avec une spontanéité et une fulgurance qui surprend
le créateur lui-même et le laisse admiratif, admiratif du processus
avant d’être admiratif de l’œuvre.
C’est un coin de montagne où mon esprit et mon corps se sentent bien. Il y a de la force en ce lieu, une force qui nourrit. Non que les montagnes dominent ou écrasent par leur élévation ou leur escarpement. Plissées, retournées, malaxées, les couches géologiques bouleversées témoignent de mouvements qui ne sont pas à échelle humaine. On dirait un océan pris par la tempête dont les eaux auraient subitement gelé. Paysages sublimes créés pour notre regard par notre regard. Matière disloquée qui garde le souvenir de son unité dans le mouvement. Forces toujours à l’œuvre sous nos pieds.

Sous nos pieds et
sur nos têtes. Ciels bleus que des petits nuages blancs ainsi que ces
rochers en mouvement lent font exister par contraste. Bleu le jour, noir la
nuit, constellé d’éclats d’étoiles, de nébuleuses
et de galaxies. Ciels de plomb parfois, terre prisonnière des nuages,
si lourds que les pierres n’y résistent pas. Mais les êtres vivants,
eux, apprécient: de la roche pulvérisée, de l’eau, de la
lumière, cela leur suffit. Cela me suffit aussi aujourd’hui, presque.
Le genre d’endroit où il me plairait d’expérimenter la vie dans
des cabanes-cocons entre arbres et nuages.
Ce bout de terrain là-haut
m’a toujours attiré. Il est plus favorable à la pousse des cailloux,
du thym et de la lavande sauvages qu’à l’agriculture. Cela me convient.
À force de lui rendre visite je commence à bien le connaître:
les animaux qui passent et ceux qui s’y arrêtent; la course du Soleil;
les couloirs des vents et ceux de l’eau; le grand amandier; la vue qui porte
loin et haut… Un bel endroit pour se sentir exister et pour créer.
Je sais depuis longtemps où
sera la maison: juste à côté de l’amandier, jusqu’à
l’embrasser. Je l’ai su dès ma première visite. C’est encore plus
évident aujourd’hui. Surtout depuis ce jour où je l’ai vue presque
se matérialiser, non pas en rêve, pour de vrai. C’était
l’été dernier. Un orage venait de passer. Des formes prenaient
consistance, nées de la vapeur montant d’un sol surchauffé. Et
là, près de l’amandier, dans la lumière d’un Soleil réapparu
entre-temps, se dessinait l’esquisse d’une maison. Un jour nos maisons seront
toutes d’air, d’eau et de lumière. Un futur possible qui se construit
dès à présent.
Depuis cette apparition je
n’ai rien entrepris. Ou du moins pas grand chose. Je me suis contenté
de laisser mûrir cette vision au-dedans tout en rassemblant les matériaux
nécessaires à la construction. J’attends, comme attend la graine
enfouie dans la terre. Elle sait infailliblement quand le moment arrive de germer.
Il n’y a rien à forcer, rien à précipiter. Cela vient un
jour. C’est ainsi qu’un matin de printemps je me réveille avec cette
certitude accompagnée de l’élan d’entreprendre la construction.
D’abord je me contente de parcourir
le terrain en tous sens: je marche, j’avance, je recule, je tourne, je saute,
je m’arrête, je repars…

Ou plutôt "quelque
chose" marche, tourne, saute… C’est moi et ce n’est pas moi. Il n’y a pas
que ma volonté qui commande à mon corps. Il est à cet instant
le point de convergence d’une multitude de forces venues de la Terre, de Gaïa,
du Soleil, de la Lune, de Corinne aussi qui va habiter ici… La cohérence
de toutes ces intentions renouvelle ma vision et donne à ma danse le
pouvoir de la manifester. Parfois je m’arrête pour planter un piquet,
marquant l’emplacement et la hauteur d’un arbre de la structure. Pourquoi
ici? c’est évident: parce que tout l’univers est ce qu’il est, à
cet instant!
En quelques minutes le volume
habitable est délimité. Mais je ne le vois pas encore, étant
trop en moi ou bien trop hors de moi. Ce n’est qu’une fois sorti de ma transe
créatrice que je puis le contempler. Prenant du recul, je compte 20 piquets
qui dessinent 7 polygones irréguliers, 2 hexagones et 5 pentagones, dont
un qui encercle l’amandier. Cela me plait. J’imagine déjà les
nuages posés sur ces arbres. Cela me plait énormément.
Cela plait aussi à Corinne. Ainsi qu’à Petit-Chat (parce qu’il
n’est pas grand) qui commence à se promener entre les arbres et
à s’y frotter.
La suite du chantier se déroule
avec facilité, pour ne pas dire avec grâce: un peu de terrassement
pour ôter quelques cailloux, déraciner les ronces et égaliser
le sol (sans aller toutefois jusqu’à le rendre parfaitement plat, ce
n’est pas nécessaire); plantation des arbres, chaque tronc étant
constitué de bambous solidement liés; pose d’une géomembrane
pour étanchéifier le sol, recouverte ensuite de quelques centimètres
de terre; fixation des branches, elles aussi en bambous; prise des mesures pour
la fabrication des coussins gonflables en ETFE (sur ce matériau et sur
le principe des coussins gonflables, voir livre 1
quatrième partie); fixation des coussins aux branches (chemin faisant
un arbre a dû être raccourci de quelques centimètres
pour améliorer le profil de la structure, et un coussin retaillé
à cause d’une petite faute d’inattention lors du report des mesures).
Voilà, quelques jours
suffisent pour mettre hors d’eau une surface d’environ 200 m², pour construire
une surface de démarcation dont la hauteur varie à l’intérieur
de 3 à 8 mètres, structure légère et résistante
pesant moins que le volume d’air qu’elle enclôt. Beaucoup de lumière,
une agréable sensation d’espace, comme un paysage dans le paysage. Corinne
et moi nous y sentons bien. Elle pourra peindre à l’aise. Nous nous empressons
d’y installer nos cabanes-cocons prêtes depuis quelques jours déjà.
Ce n’est pas fini mais c’est déjà habitable. Reste à accrocher
des murs-rideaux, installer une voile de protection solaire et quelques autres
accessoires. L’essentiel est fait, la suite se fera à son rythme, nous
avons le temps…

Vous souhaiteriez
visiter notre maison? C’est avec plaisir que nous vous accueillerions et vous
inviterions à déguster une tasse de thé si elle existait
pour de vrai. Hélas, vous l’aurez compris en regardant l’image, elle
n’existe pour le moment qu’à l’état de maquette. Le paragraphe
précédent raconte l’histoire à peine romancée de
sa construction sur laquelle je reviendrai en détails dans la quatrième
partie. Pour une réalisation en vraie grandeur, il faudra attendre.
Je n’ai ni le terrain ni les autorisations ni les partenaires (comme pour tout
procédé nouveau, il y a une foule de détails pratiques
à régler qui requièrent un esprit plus technique et moins
conceptuel que le mien). Qui sait? un jour peut-être, avec l’appui d’un
mécène forcément généreux et d’un technicien
bien inspiré…
En attendant, j’ai tenu à
raconter cette histoire pour montrer dès à présent que
toutes les considérations précédentes qui semblaient bien
éloignées de l’architecture ont finalement des conséquences
concrètes dans ce domaine; pour suggérer qu’il doit être
effectivement possible de construire autrement, dans la simplicité, la
légèreté, l’adaptabilité, des maisons simultanément
accordées à ses habitants, à la Terre qui les porte, à
Gaïa qui les nourrit, au cosmos qui les inspire. Reste tout de même
une question importante que je ne puis retenir plus longtemps, formation d’ingénieur
oblige: est-ce qu’en vrai des maisons construites ainsi en dansant vont tenir?
Depuis le 19e siècle,
l’analyse mécanique des constructions à l’aide de méthodes
mathématiques occupe une place essentielle. D’abord réservées
aux projets les plus ambitieux, elles sont aujourd’hui la norme dans pratiquement
tous les domaines de la construction. Avancée permise par une meilleure
connaissance des matériaux, une production industrielle desdits matériaux
à qualité constante, des progrès dans la compréhension
des structures, et enfin des performances des ordinateurs qui rendent possibles
la résolution en un temps raisonnable de milliers d’équations.
C’en est au point où le moindre catalogue de poutres, qu’il s’agisse
de métal, de béton ou de lamellé-collé, comporte
des indications précises sur les déflections et les charges admissibles.
Derrière cette généralisation
il y a bien évidemment un souci de sécurité et d’économie.
De trop nombreux ouvrages se sont écroulés, engloutissant hommes
et argent, pour qu’on ne prenne pas quelques précautions. Reconnaissons
que l’établissement de normes de sécurité parallèlement
à des méthodes de calculs efficaces ont eu des effets bénéfiques.
On sait aujourd’hui construire des immeubles de plus de 500 mètres de
haut et des ponts de plus d’un kilomètre de portée sur lesquels
personne n’a peur de monter. On peut craindre le vertige, mais pas que le plancher
dégringole sous nos pieds.
La méthode ayant fait
ses preuves, on en est arrivé à penser qu’on ne doit construire
que des structures dont on sait calculer le comportement. Mais derrière
des succès exemplaires et des soucis louables, il ne faut pas nous leurrer,
l’approche a tout de même des limites.
La première est celle
de la modélisation elle-même. Pour calculer les réactions
d’une structure à des forces telles que le passage de personnes ou de
véhicules, le vent, les séismes, etc., il faut en construire un
modèle mathématique (par exemple selon la méthode dites
des éléments finis, les spécialistes comprendront).
Or un tel modèle n’est pas la réalité. Il n’est même
pas une représentation simplifiée de la réalité.
Il est une abstraction plaquée sur l’objet réel qui permet de
faire des calculs dont les résultats peuvent être confrontés
à des mesures expérimentales. On peut ainsi modéliser une
poutre en la réduisant à un certain nombre de points et en simulant
les déplacements de chaque point par des équations. Là-dessus
on fait des calculs, en commençant par des situations très simples,
pour conclure, par exemple, que la déflection centrale sous une charge
uniformément répartie devrait être de tant. On valide le
modèle en confrontant ce résultat avec l’expérience. Si
l’écart est trop important on affine le modèle. S’il est faible,
on considère le modèle comme valable pour des efforts d’un certain
type et ne dépassant pas certaines valeurs. On peut alors s’en servir
pour tester par le calcul le comportement d’une structure dans diverses configurations,
par exemple sous une charge en mouvement.
Construire un modèle
est tout un art. Non seulement on ne sait jamais jusqu’à quel niveau
de précision il faut descendre (trop de précision rend les calculs
exagérément longs), mais en plus on ne peut pas prévoir
tous les types d’événements à analyser. La Nature en la
matière est plus patiente et créative que l’homme pour
faire surgir des comportements totalement inattendus. Voici par exemple ce qu’on
a observé sur certains ponts suspendus: de surprenantes oscillations
des câbles porteurs par pluie modérée associée à
un vent modéré. En y regardant de près, les ingénieurs
ont fini par comprendre ce qui se passait. Par pluie modérée,
les gouttes qui se forment sur le câble ne sont pas assez grosses pour
se détacher et tomber. Elles glissent autour et se rassemblent sur la
face inférieure où elles courent en un long filet. De ce fait
le profil du câble est modifié et donc sa prise au vent. Par vent
faible, cela n’a évidemment aucune incidence. Par vent fort non plus
car alors le filet d’eau est disloqué. C’est par vent modéré
que l’on observe les effets les plus forts. Le filet n’est pas disloqué,
le profil devenu asymétrique du câble prend le vent, des oscillations
apparaissent qui peuvent s’amplifier selon sa vitesse et la fréquence
de résonance propre du câble. Personne n’avait évidemment
pensé à prendre en considération un tel événement.
Heureusement, les grands ponts modernes sont continuellement surveillés.
Le phénomène une fois découvert et analysé, une
solution simple a été trouvée avant qu’il ne se reproduise
avec des conséquences éventuellement plus dommageables: entourer
le câble d’une petite gouttière hélicoïdale qui empêche
la formation d’un filet d’eau rectiligne. Finies les oscillations par pluie
modérée et vent modéré. Mais qui sait si en d’autres
circonstances tout aussi imprévisibles on ne verra pas surgir de nouveaux
problèmes, à cause pourquoi pas de cette gouttière…
Une autre limite de l’approche
mathématique tient à la valeur des coefficients de sécurité.
Disons-le franchement, elles sortent souvent du chapeau. Pourquoi une structure
tendue doit-elle être conçue avec un coefficient de sécurité
de 6? (c’est-à-dire que pour une membrane typique d’une résistance
à la tension de 100 kg/cm la charge maximale permise est d’un sixième
de cette valeur soit 17 kg/cm) pourquoi pas 5 ou 10? Mystère. Parfois
les normes semblent carrément le résultat de négociations
implicites ou explicites entre partis aux intérêts divergents.
Par exemple le sud-est de la France est une zone à la sismicité
reconnue. Mais il n’en est guère tenu compte dans les constructions.
On ne sait pas quand mais on sait qu’un jour se produira dans la région
un tremblement de terre important. Beaucoup de maisons s’écrouleront,
hélas dans bien des cas sur leurs habitants.
Ceci dit, je reconnais volontiers que l’analyse mathématique des structures alliée à l’amélioration des matériaux a fait faire un énorme bond à la construction. Le gain en hauteur et en portée est d’un facteur de l’ordre de dix par rapport aux plus grands édifices datant d’avant l’ère moderne. Et il est d’un facteur cent par rapport à ce que peuvent faire des autoconstructeurs. Pareille disproportion suggère qu’on ne doit pas traiter de la même manière nos maisons, même recourant à des procédés originaux non validés par des siècles de pratique ni par modélisation mathématique. L’autoconstructeur a mieux à faire que cinq années d’études d’ingénieur suivis d’une année de calculs avant de se mettre au travail. Il doit pouvoir réaliser une grande structure sûre (du type arbres et nuages, dôme géodésique ou d’autres que je présenterai dans la quatrième partie) sans avoir à effectuer le moindre calcul. J’ajoute: sans avoir non plus à surdimensionner à l’aveuglette tous les éléments, augmentant le travail, le coût, l’impact sur l’environnement, détruisant l’esthétique et n’améliorant pas forcément la sécurité. Pour bien nous convaincre que c’est possible, j’ai choisi de dire quelques mots de l’art des ponts de Robert Maillart. Choix qui tient d’une part à l’intéressante approche de Maillart, d’autre part au fait que la construction d’un pont est bien plus critique que celle d’une maison, la moindre erreur conduisant irrémédiablement à la destruction de l’ouvrage.
Des très vieux ponts en parfait état, il n’en existe guère. Longtemps l’art de construire les ponts est resté très approximatif et la plupart se sont écroulés sous des charges excessives ou des assauts de la Nature. Quelques ouvrages subsistent tout de même des temps anciens, soit qu’ils aient été plusieurs fois rénovés, soit qu’ils soient restés préservés de contraintes excessives (comme le pont du Gard, en fait un aqueduc), soit qu’ils aient été particulièrement bien construits par des ingénieurs talentueux. Un exemple remarquable, le pont de l’Alcantara en Espagne qui enjambe le Tage, édifié vers l’an 100 par un ingénieur dont on ne connaît que le nom, Caïus Julius Lacer.
 |
longueur
totale 180 m, portée maximale 30 m, hauteur maximale 50 m dans bridges, de David J. Brown, Macmillan 1993, p 25 |
Pendant 2000 ans
les progrès ont été minimes, dus seulement à une
lente accumulation d’expérience. Subitement au 19e siècle les
choses s’accélèrent. De nouveaux matériaux (acier, béton…),
de nouveaux procédés structuraux (treillis, coffrages, poutre
en T et en H) combinés avec l’analyse mathématique
permettent de repousser considérablement les limites en termes de capacité
portante (il faut faire passer de lourds trains de marchandises), de portée
(pour franchir sans détours des fleuves et des détroits) et de
hauteurs (pour laisser le passage dessous aux plus grands navires).
Le béton a été
inventé (ou réinventé, les romains en connaissaient une
variante) dans le premier quart du 19e siècle. Très vite on s’en
est servi pour construire des ponts. Mais comme ses propriétés
n’étaient pas bien connues, les premières réalisations
ressemblaient à des ponts en pierres. Au fond on se servait du béton
en guise de pierre reconstituée. C’est à des ingénieurs
comme Hennebique, Maillart, Freyssinet que l’on doit des avancées importantes
tirant partie de ses spécificités.
Robert Maillart (1872-1940)
m’intéresse tout particulièrement pour sa démarche originale
qui tranche avec les pratiques de l’époque. C’était déjà
la norme en son temps de concevoir les ponts avec force recours aux mathématiques.
Comme je l’ai dit, cela a permis de formidables avancées. Mais cela a
aussi fini par avoir un effet pervers: brider la créativité. Finies
les fantaisies, avant tout se rassurer en ne construisant que ce que l’on sait
calculer. Pas de problème lorsqu’on se contente de traiter le béton
comme de la pierre reconstituée. Mais quand on commence à avoir
affaire à du béton armé (inventé par Monier en 1867),
de surcroît employé dans des configurations nouvelles, on ne sait
pas à l’époque faire les calculs.
Maillart est un créateur
intuitif qui ne va pas s’interdire de penser ni d’agir pour si peu. Il sent
le matériau pourrait-on dire. Il a également un grand sens des
structures. Il parvient ainsi à concevoir des formes qui, tout en étant
très élégantes, résolvent les problèmes structuraux
efficacement et avec une grande économie de moyens. Pour preuve le pont
de Salginatobel.
 |
FBM Studio/Mancia/Bodmer |
Achevé en
1930, il a une portée de 90 m à 80 m au-dessus de la
rivière Salgina en Suisse. Ce n’est pas le plus grand de ses ouvrages
mais incontestablement le plus spectaculaire et le plus représentatif
de son art.
"Pendant toute sa vie
il s’est préoccupé d’esthétique sans jamais faire appel
à un architecte, sauf au début de sa carrière lorsqu’on
l’y contraignait afin de satisfaire les autorités communales. D’après
lui celles-ci avaient une "antipathie atavique" pour ses innovations.
Il conçut seul tous ses grands ouvrages, méprisant les architectes
qui voulaient donner aux ponts une allure monumentale. En revanche il partageait
avec eux et avec quelques journalistes spécialisés un goût
pour l’analyse esthétique des ouvrages d’art. D’ailleurs les architectes
furent les premiers à reconnaître l’intérêt des structures
de Maillart, bien avant les ingénieurs en génie civil… Quelques
années plus tard, les experts en génie civil comprirent enfin
que les ponts de Maillart étaient des merveilles techniques… Avec du
recul, on comprend que Maillart appartient à l’école de John Roebling,
qui conçut le pont de Brooklyn, et de Gustave Eiffel, qui construisit
également de nombreux ponts et viaducs. La préoccupation première
de ces trois hommes était l’esthétique: ils commençaient
par dessiner la silhouette de leur ouvrage et, ensuite seulement, ils utilisaient
des techniques d’analyse simple pour les rendre viables." (David Billington,
les ponts légers de Robert Maillart, Pour la Science n°275, septembre
2000)
Tout le monde n’a
pas le génie de Maillart pour concevoir intuitivement des formes si bien
accordées au matériau et aux contraintes. Pour preuve ses ouvrages
tiennent (à l’exception du pont de Tavanasa détruit en 1927 par
un glissement de terrain). Mais il n’est pas non plus le seul à manifester
ce talent: voir par exemple les récentes réalisations de Santiago
Calatrava pour rester dans les ponts, ou de Frei Otto dans le tout autre domaine
des structures tendues et autres structures légères.
Une maison supporte en général
des contraintes moindres qu’un pont. Donc un moindre talent ou juste un peu
de savoir-faire devraient suffire pour qu’elle tienne. Un minimum est requis
tout de même si l’on ne veut pas retomber dans les travers de la répétition.
En rappelant au passage que ‘tradition’ en matière de construction est
hélas souvent synonyme de banalité des formes et de gros défaut
structuraux. En rappelant aussi que les nouveautés, beaucoup sont disposés
à les adopter, à condition que d’autres au préalable en
aient vérifié la solidité. Même ceux qui aiment prendre
des risques dans leur vie attendent d’une maison un minimum de sécurité:
au moins qu’ils ne risquent pas de la prendre sur la tête chaque fois
qu’il pleut ou qu’il vente. Ce qui ressort de tout ce qui précède,
c’est qu’en matière de sécurité des constructions:
1. la résistance
n’est pas le premier problème, elle doit découler ‘naturellement’
de la combinaison forme-matériaux (au sens où des structures
comme celles de Frei Otto sont ‘naturelles’, voir à ce propos le livre
2 troisième partie, § imitation des forces formatives physiques);
2. la recherche d’une
résistance maximale, que ce soit par le calcul en appliquant des coefficients
de sécurité surmajorés ou en surdimensionnant empiriquement
les éléments de structure, n’est en rien une garantie;
3. faire le choix de
la légèreté minimise considérablement les risques:
à ma connaissance personne n’est jamais mort pour s’être pris
sur la tête une toile de tente lors d’un tremblement de terre, tandis
qu’une poutre, une brique, ou une tuile…
4. en faisant le choix
de structures qui restent facilement accessibles (à l’instar du gréement
d’un voilier par exemple) il est possible d’intervenir en cours de vie du
bâtiment pour l’adapter aux contraintes locales; de telles structures
sont courantes dans la Nature, par exemple les os des vertébrés
ou les troncs des arbres qui se renforcent automatiquement en fonction des
contraintes qu’ils subissent.
La Nature fournit des exemples encore plus pertinents de véritables structures architecturales s’adaptant au milieu et aux contraintes, comme cette toile d’araignée géante:
 |
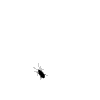 |
|
toile
d'araignées Anelosimus eximius |
Anelosimus eximius est une des rares espèces d’araignées sociales. Sur quelques 35 000 espèces d’araignées identifiées, seulement une quinzaine ont un comportement social. Elles vivent en colonies de quelques milliers d’individus, coopérant à des activités telles que s’occuper des cocons, nourrir les petits, capturer des proies, et bien sûr tisser cette énorme toile qui couvre plusieurs dizaines de mètres carrés. Sa construction n’obéit pas à un plan précis et ne résulte pas non plus d’un comportement parfaitement organisé avec répartition des tâches (comme chez les abeilles). Chacune tend ses propres fils, se contentant de tenir compte de ce que les autres ont déjà fait pour combler des manques ici ou renforcer la toile là où les contraintes apparaissent trop fortes. Au final, la structure tient non parce qu’elle a été conçue pour tenir mais parce que chaque action individuelle menée localement permet qu’elle tienne.
L’important à retenir est que la réponse au problème de la sécurité des habitants dans un bâtiment soumis à des forces variées aux effets pas toujours prévisibles ne passe pas nécessairement, comme on le pense trop souvent, par la recherche d’une résistance maximale de la structure. Il y a d’autres possibilités très différentes, beaucoup plus simples et économiques à mettre en œuvre, particulièrement appréciable en autoconstruction, tout en étant plus sûres, du moins tant qu’on reste à l’échelle d’une maison:
1. Laisser la structure accessible pour qu’elle soit facile à consolider si besoin est. Comme les araignées ci-dessus, si un ancrage présente des faiblesses, il suffit de rajouter un câble, et un autre jusqu’à ce que ça tienne. Autre exemple concernant la réalisation d’un mât: à la place d’un élément monobloc forcément lourd, difficile à transporter et encore plus à dimensionner quand on n’a pas idée de toutes les forces qui vont peser dessus, on préfèrera un assemblage de tiges fines.
 |
 |
Séparément, chaque élément est léger et facile à transporter. Au départ le nombre d’éléments qui forment un tronc est fixé intuitivement ou en fonction de l’expérience. Ensuite il peut être adapté facilement pour tenir compte des déformations réelles observées. Notons qu’ajouter des éléments de cette façon ne nuît pas à l’esthétique.
2. Des éléments susceptibles de subir des contraintes excessives dans des situations inhabituelles peuvent être rendus démontables. Les japonais ont un proverbe: "Il est plus rapide en cas d’incendie de démonter la charpente que d’aller chercher de l’eau." Dans la maison que je conçois ici, la fixation des coussins gonflables peut constituer une zone de faiblesse en cas de vents très violents. Plutôt que de réaliser à un coût exorbitant une structure capable de résister à des tempêtes séculaires, mieux vaut la concevoir démontable. Une fois les coussins démontés, dégonflés et rangés à plat par terre, le reste du bâtiment n’offre plus guère de résistance au vent et ne risque donc rien. Quant aux habitants, il leur est facile de prévoir des abris où séjourner quelques heures. Rien de neuf, c’est ce que font régulièrement les habitants des pays tropicaux en cas de cyclones. Réapprenons à faire de même plutôt que nous construire des forteresses qui ou bien ne servent jamais (cf. la ligne Maginot ou les remparts de Carcassonne), ou bien tombent en ruine faute d’entretien, ou bien finissent tout de même par être détruites par des forces imprévues.
3. Et si justement l’on est pris par surprise et que le bâtiment s’effondre? les risques pour les habitants seront d’autant plus faibles que la structure sera légère, disons pesant au total un poids du même ordre que le volume d’air qu’elle contient (pour mémoire un mètre cube d’air pèse un peu plus d’un kilo et une habitation de 200 m² comprend de l’ordre de 500 à 1000 mètres cubes selon la hauteur). Ajoutons que même si tout est par terre, ce n’est pas nécessairement synonyme de dégâts importants. Prenez une tente de camping moderne, cassez un arceau, tout s’effondre. Mais il n’y a aucun autre dommage et il est facile à réparer.
La manière
de pratiquer l’architecture que je viens d’esquisser tranche avec ce qui se
fait habituellement. Cela ne veut pas dire que je la considère comme
la seule approche valable désormais. Je reste un farouche partisan de
la liberté. D’autant plus que nous sommes dans un domaine où il
n’y a aucune vérité à trouver, seulement à rechercher
une cohérence entre ce que l’on a envie ou besoin de vivre et l’expérimentation
concrète dans la matière. En fait mon but est double en conduisant
cette recherche.
D’abord suggérer que
la créativité n’a pas de limites, qu’elle n’est pas réservée
à l’agencement d’une façade ou à la distribution des pièces
sur un plan. Elle a sa place à tous les niveaux de la pratique architecturale.
Pour prendre des exemples connus, Gaudi, Buckminster Fuller ou encore Frei Otto
ont chacun à leur manière réinventé la manière
de pratiquer l’architecture, avec des résultats remarquables. Encore
une fois comprenons-nous bien: je ne dis pas qu’il est nécessaire de
tout réinventer tout le temps; j’invite seulement à ne pas se
limiter et à ne pas hésiter à remettre en cause les habitudes
si l’on en ressent le besoin et l’élan.
Mon autre but est de répondre
au défi que je me suis lancé à moi-même: trouver
une manière de construire qui soit cohérente avec ma conception
de la maison, que je veux extension du corps de l’homme appartenant au
corps de Gaïa. Le geste créateur est ma réponse. Probablement
pas la seule possible, du moins celle qui me vient aujourd’hui étant
donnés mes goûts actuels et mon niveau de compréhension
du moment. Elle me plait aussi tout simplement pour ses côtés ludique
et pas prise de tête. Même si je me suis énormément
pris la tête pour en arriver là! En tous domaines l’extrême
simplicité se dévoile au bout d’un long parcours. Il m’aura fallu
trois livres, sans compter tous les travaux préparatoires. Encore un
petit effort, nous y sommes presque…
"Le trait tracé
engendre l’espace qui l’entoure, et il n’est plus la projection du monde, mais
la projection de celui qui peint. Fusionnent alors deux espaces imaginaires:
celui extérieur du monde, celui intérieur de l’être… Les
peintres contemporains donnent une image de la structure de l’espace qui doit
être assimilée avant de s’épanouir dans les agglomérations
futures." (Olivier Debré, espace pensé, espace créé,
le signe progressif, le cherche midi éditeur 1999, p 120-1)
Belle idée! L’ennui
est que la transposition de l’espace des peintres contemporains, qui est effectivement
d’une richesse extraordinaire, à l’espace architectural, d’une affligeante
pauvreté en comparaison, n’est pas immédiate. Elle bute en particulier
sur les limites de notre appréhension de la matière, fonction
de notre niveau de conscience du moment. Car l’architecture utilise la matière
dans toutes ses dimensions, notamment d’étendue et de masse, tandis que
la peinture, elle, n’est qu’un médium servant à recréer
des apparences visuelles, notamment en couleurs et textures. Pour preuve, de
plus en plus d’artistes créent des images directement sur ordinateur,
sans matière donc. Je sais aussi que, dans le même temps, nombreux
sont les peintres aujourd’hui qui disent travailler la matière.
Mais cela consiste à l’utiliser à seule fin de représentation,
sans considération de sa pleine matérialité. Cela n’exige
pas donc d’aller véritablement à sa rencontre. Un Compagnon qui
taille la pierre ou le bois est plus proche de ce que j’entends par rencontrer
la matière. Je tiens cependant à ajouter que cette rencontre n’est
pas nécessairement un affrontement dont l’issue dépend de la longueur
et de la difficulté de l’épreuve (presque tous les sculpteurs
parlent de leur lutte acharnée contre le bois, la pierre ou l’acier).
J’ai brièvement évoqué plus haut les résultats remarquables
obtenus par Viktor Schauberger dans la construction d’ouvrages hydrauliques.
Voici comment il raconte sa rencontre avec l’eau:
"Je pouvais rester assis
des heures à contempler l’eau qui coulait sans jamais en ressentir le
moindre ennui. Je n’avais pas encore réalisé que l’eau recèle
les plus grands secrets. Je ne savais pas non plus que l’eau est le support
de la vie, ou la source originelle de ce que nous appelons conscience. Sans
aucune idée préconçue, je laissais simplement mon regard
suivre le courant. Ce n’est que des années plus tard que j’ai commencé
à réalisé que l’eau courante attire notre conscience comme
un aimant, et en emporte une partie dans son sillage… Le temps passant, je me
mis à jouer avec les pouvoirs secrets de l’eau. Je laissais l’eau s’emparer
de ma conscience. Le jeu devint de plus en plus sérieux, au point que
je réalisai que l’on pouvait détacher la conscience de son corps
et l’attacher à celle de l’eau. Quand ma conscience me revenait, l’esprit
caché de l’eau me révélait des choses extraordinaires.
C’est ainsi qu’un chercheur est né, qui pouvait envoyer sa conscience
dans des voyages d’exploration. J’étais capable d’expérimenter
des choses qui avait échappées aux autres, parce qu’ils ne savaient
pas que l’être humain est capable d’envoyer sa conscience en des lieux
que le regard n’atteint pas. Grâce à cette vision intérieure,
j’ai développé un lien avec la nature mystérieuse, dont
j’ai appris à percevoir et à comprendre l’être essentiel."
(Callum Coats, living energies, Gateway Books 1996, extrait du chapitre
1, traduction personnelle)
Que ce soit la pierre, le bois,
l’acier, le béton, le plastique, l’air, l’eau ou encore la lumière,
nous avons le potentiel de nous relier très profondément à
la matière. Pas d’une manière purement descriptive ni sensible
(je veux parler des sensations qu’elle produit en agissant sur le corps), mais
dans une intimité du même ordre que celle que nous éprouvons
avec notre propre corps. Et avec lequel nous agissons, ce qui veut dire que
cette connaissance que nous acquérons ainsi de la matière nous
permet véritablement de jouer avec. Cela a deux conséquences importantes:
D’abord elle n’apparaît
plus comme une limite à l’incarnation de nos rêves. J’ai déjà
évoqué cette idée dans le livre 2
troisième partie, § formes naturelles lorsque je remarquais
que les êtres vivants savent jouer avec la matière pour manifester
leurs intentions, y compris les plus extravagantes. Eh bien il doit en aller
de même pour l’homme en architecture (et dans d’autres domaines,
cf. à nouveau l’exemple de Schauberger): elle n’est pas une limite à
la matérialisation de nos rêves, elle est un médium aux
possibilités infinies avec laquelle nous devons apprendre à jouer.
Nous retrouvons au bout du compte ce que réalisent les peintres sur leur
toile, mais pour faire maintenant des objets en trois dimensions capables de
résister à diverses contraintes physiques.
L’autre idée importante
est que ce travail sur la matérialisation de nos rêves n’est pas
qu’un mouvement du dedans (l’esprit) vers le dehors (le monde physique). C’est
aussi et simultanément un mouvement dans l’autre sens du dehors vers
le dedans. Car pour parvenir à ce résultat il faut ‘incorporer’
la matière, au sens quasi littéral, l’intégrer à
son corps. La ressentir donc de l’intérieur comme on ressent son propre
corps pour finalement en faire un lieu de projection de nos intentions, aussi
facilement et efficacement que l’on réalise dans le corps des intentions
telles que lever le bras ou marcher. C’est en quelque sorte une dilatation du
corps qui, du coup, dépasse la frontière de la peau. C’est ainsi
que la maison devient véritablement une extension du corps de l’homme.
J’ajoute un dernier aspect
intéressant quoique plus anecdotique. Concevoir-construire une maison
par le geste créateur conduit à délimiter d’abord l’espace
où l’on vit, le volume intérieur habitable, et dans un second
temps seulement le volume extérieur que l’on voit. Le contraire donc
de l’approche architecturale traditionnelle qui démarre systématiquement
par le tracé des formes extérieures. Approche parfaitement sensée
dans le cadre d’une Vision qui ne tient guère compte de l’homme,
mais qui ne l’est plus dès qu’on lui redonne sa place.
Dans des états de conscience modifiés bien connus des chamans, on peut accéder à d’autres dimensions de la réalité (personnellement je me suis identifié à l’ADN et j’ai expérimenté mon corps-eau), on peut se relier à d’autres corps (j’ai connu les sensations d’un corps de femme, je me suis transformé en serpent; toutes ces expériences sont racontées dans vers l’homme de demain), on peut se relier en esprit à d’autres espèces animales ou végétales (voir en particulier l’invention étonnante de la recette de l’ayahuasca rapportée par Jeremy Narby dans le serpent cosmique, éditions Georg). Quel rapport et quel intérêt pour l’architecture? J’en vois au moins deux.
Le premier est qu’il
est possible de se relier à Gaïa d’une manière très
profonde qui n’est pas une simple contemplation de l’extérieur ni une
projection de nos attentes, à l’instar de ce que l’on vient de voir à
propos de nouveaux rapports à établir avec la matière.
Cela s’apparente à une connexion directe d’esprit à esprit qui
véhicule des connaissances dont certaines sont immédiatement utilisables.
L’idée est qu’un architecte-constructeur néo-chaman a la possibilité
de projeter dans sa construction des informations qui le relient intimement
à certaines facettes de Gaïa, en faisant de la sorte une véritable
extension du corps de Gaïa.
Pour ce faire il n’est pas
indispensable de rentrer dans des transes profondes en usant de substances psychotropes.
Des transes légères suffisent, comme en connaissent tous les créateurs
dans ces moments magiques où l’inspiration survient. C’est là
que l’on retrouve l’importance et l’intérêt du geste créateur
en architecture. C’est un état de création qui permet à
l’architecte-chaman d’accéder à des dimensions transpersonnelles,
et dans le même instant de projeter par le geste dans la réalité
physique certaines informations ainsi acquises. Le créateur devient un
simple médium, un intermédiaire. Il n’est pas nécessairement
conscient de tout ce qui passe à travers lui, au contraire d’un chaman
habitué des transes profondes induites par des plantes psychotropes.
C’est sans importance pour ce qu’il a à faire ici. Le canal est ouvert,
et ce qui passe est accordé aux capacités du médium. S’établit
de manière subliminale une relation triangulaire homme-Gaïa-bâtiment
qui réalise l’accord instantané (c’est-à-dire dans l’instant
de la création) intention-forme-fonction-structure-matières-site…
Cette approche est
à même de nous conduire encore plus loin. Pour comprendre il faut
mettre en parallèle deux idées. L’une est le désir de rentrer
dans un jeu de co-création avec Gaïa pour co-évoluer. J’ai
déjà évoqué cette idée abondamment développée
dans d’autres de mes ouvrages, notamment vers
l’homme de demain. L’autre est la similitude entre des expériences
où le chaman entre en contact avec l’esprit d’une espèce animale
ou végétale et les co-évolutions dans la Nature comme celle
entre la guêpe et l’orchidée (racontée dans le livre
précédent, troisième partie, § co-évolutions).
Donc en se reliant de la sorte
à Gaïa il est possible non seulement de manifester un état
présent, mais aussi, et c’est ce qui m’intéresse davantage, de
jouer des jeux de co-créations pour explorer des futurs possibles. En
cela la maison devient support d’évolution, cocon de métamorphose.
Il est probable que peu nombreux
aujourd’hui sont les architectes-chamans capables de nous aider à explorer
cette facette inédite de l’expérience humaine. Mais il est intéressant
de savoir que cette possibilité existe en germe dans cette approche architecturale
par le geste créateur. Je suis certain que d’autres auront plus de talent
que moi pour la développer.
Quand un être vivant déclenche intérieurement la poussée qui va le conduire à prendre corps, il est automatiquement à un point de convergence de toutes les forces cosmiques. Une plante qui germe à l’arrivée du printemps n’a pas à regarder le calendrier ni à faire une cérémonie pour célébrer l’équinoxe. Parce que tout-ce-qui-est est ce qu’il est, parce que la plante est ce qu’elle est, parce que tout est lié, elle germe, un point c’est tout. Elle prend sa place parmi le Minéral et le Végétal, sinon elle ne germe pas, ou disparaît très vite dans l’estomac de quelque animal.
Tant que la maison est une construction de l’homme et pas un être vivant comme un arbre, c’est à lui d’être en quelque sorte le facteur déclenchant la germination, c’est donc à lui d’être l’intermédiaire entre les forces cosmiques et la matérialisation. Trois séries de paramètres sont à prendre en compte: les paramètres locaux, les paramètres fixes de la Terre, et les paramètres extra-terrestres.
Les paramètres locaux concernent la circulation de l’eau, la nature du sol et du sous-sol, la circulation de l’air, l’ensoleillement (et plus généralement les flux électromagnétiques), plus toutes les espèces animales et végétales vivant là. La maison doit faire corps avec l’environnement, comme née elle aussi de la Terre; elle ne doit pas sembler juste posée là, venue d’on ne sait où. Bien que construite par l’homme, elle révèle son appartenance au corps physique de Gaïa.
D’autres paramètres conditionnent le positionnement et l’orientation de la construction, les données physiques du globe terrestre en ce point précis, considérées comme fixes par rapport à la durée de vie du bâtiment:
1. l’axe selon
lequel la masse terrestre exerce sa force d’attraction gravitationnelle; c’est
par définition la verticale du lieu, qui définit simultanément
le plan horizontal comme lui étant perpendiculaire;
2. l’axe de rotation
de la Terre, qui définit le nord géographique, et qui renferme
aussi l’information sur la latitude du lieu (qui conditionne notamment la
trajectoire apparente du Soleil et la durée du jour);
3. le magnétisme
terrestre, défini par la déclinaison, qui est l’écart
entre le nord magnétique et le nord géographique dans le plan
horizontal, et par l’inclinaison, qui est l’angle par rapport à la
verticale.
Enfin, il y a les paramètres extra-terrestres, tous variables, à cause notamment de la rotation de la Terre qui ne permet de les fixer en hauteur et azimut qu’à une date et une heure précises. Les principaux susceptibles de jouer un rôle dans la vie du bâtiment sont, par ordre d’importance décroissante:
1. les mouvements
du Soleil avec l’alternance jour-nuit et le cycle annuel des saisons (avec
ces moments très particuliers que sont les solstices et les équinoxes);
2. les mouvements de
la Lune (avec en particulier ces moments très forts que sont la Pleine
Lune et la Nouvelle Lune);
et, de bien moindre importance au point qu’ils peuvent être généralement négligés:
3. les mouvements
des planètes;
4. la direction du centre
de la galaxie (dans la constellation du Sagittaire);
5. la direction vers
laquelle se dirige le système solaire dans son voyage autour de la
galaxie (étoile Véga)…
Comment prendre en
compte tous ces paramètres très différents? Voyons d’abord
les manières traditionnelles de faire:
En Extrême-Orient, aucune
construction d’importance ne se fait sans l’intervention d’un maître de
Feng-Shui. Il détermine à la fois le positionnement du bâtiment
(emplacement et orientation en fonction des courants d’énergie tellurique
que les chinois appellent les veines du dragon) et le moment de sa naissance
(par des considérations de type astrologique).
En Occident, selon la grande
tradition et pour les bâtiments importants, les maîtres d’œuvre
procédaient à une dédicace, c’est-à-dire qu’ils
calaient certains paramètres du bâtiment sur les paramètres
variables tels qu’ils se présentent à un moment donné,
choisi pour des raison plus ou moins obscures: équinoxes, solstices,
jour anniversaire de tel ou tel saint, etc.
Le paradoxe est que dans tous
ces cas la détermination du moment propice se fait en-dehors du temps
réel de la construction. Comme si une graine avait besoin de consulter
un calendrier pour germer. Mais un bâtiment n’est pas une graine dira-t-on.
C’est juste. Voilà pourquoi c’est à l’homme qu’il revient
d’être le récepteur des influences cosmiques pour les répercuter
sur la construction. On comprend sans peine que ce sera d’autant plus efficace
que cela se fera dans le temps même de la construction. C’est le cas dans
une approche par le geste créateur. Le bâtiment prend alors naturellement
sa place sur la Terre et dans le cosmos.
La version modernisée
des pratiques traditionnelles qui viennent d’être évoquées
s’appelle la géobiologie, un terme très à la mode
depuis quelques années. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, disons
pour faire vite qu’il s’agit d’un mélange à la marseillaise: un
tiers de pratiques traditionnelles comme les tracés régulateurs,
un tiers de pratiques traditionnelles exotiques comme le feng-shui, un
tiers de découvertes récentes d’apparence scientifique appelées
réseaux telluriques, le tout arrosé d’un bon quatrième
tiers de crédulité.
Quid de ces réseaux
telluriques? Il en existe plusieurs dont le plus connu s’appelle le réseau
Hartmann, du nom de son inventeur dans les années 50. Selon lui et ses
sectateurs prosélytes, la Terre serait parcourue par des courants dits
telluriques dont l’origine et la nature restent mystérieuses mais dont
la géométrie est très précise: des bandes orientées
nord-sud et est-ouest d’une largeur de 21 cm, les bandes nord-sud étant
espacées de 2 m et les bandes est-ouest de 2,5 m. Les croisements
appelés nœuds seraient particulièrement nocifs. Les géobiologues
y voient l’origine de nombreuses maladies, de l’insomnie au cancer.
Que faut-il en penser? Pour
moi c’est indubitablement n’importe quoi enrobé dans un langage pseudo-scientifique.
Les objections ne manquent pas:
Quand on connaît un minimum
de physique et de géométrie, il apparaît totalement aberrant
de penser qu’un corps aussi irrégulier que la Terre tant en forme qu’en
composition puisse être marqué à sa surface par des quadrillages
à la géométrie parfaite. D’autant qu’il n’existe pas qu’un
réseau: réseau Peyré, réseau Cumy, réseau
Hartmann, etc. Déjà que l’existence d’un seul est difficile à
justifier, cette pluralité signe la ruine du concept.
Au-delà de telles considérations
théoriques toujours discutables, il y a une réalité pratique
indubitable qui est qu’on a énormément de mal à les détecter.
Ils échappent totalement aux instruments de mesures scientifiques et
ne sont décelables qu’à la sensibilité à l’aide
de pendules et autres baguettes de sourciers. Ce n’est évidemment pas
une preuve de leur inexistence, la science n’ayant pas le dernier mot en tout.
Mais c’est tout de même gênant quand on prétend qu’ils ont
une réalité physique et que leur existence est scientifiquement
prouvée.
Le plus gênant dans tout
ça, c’est que les êtres vivants eux-mêmes y semblent très
peu sensibles alors que c’est censé expliquer l’apparition de nombreuses
maladies. Qui, dans des champs cultivés avec toutes sortes de plantes,
dans des champs en friches, des prés, des forêts, des fourmilières,
des chemins d’animaux, a jamais vu quoique que ce soit indiquant la moindre
présence de ces réseaux géométriques? Quant aux
primitifs qui vivent encore dans la Nature, beaucoup plus sensibles et fins
observateurs que nous puisque leur survie est en jeu, jamais aucun à
ma connaissance n’a signalé leur existence.
Je suis prêt
à admettre que certains géobiologues sont sincères lorsqu’ils
disent sentir ces réseaux. Mais les sentir ne veut pas dire qu’ils existent.
On peut les sentir de la même manière que l’on sent des arômes
de fruits rouges dans un vin blanc coloré en rouge (http://www.inra.fr/presse/le_gout_du_vin_dans_nos_tetes):
la sensation est réelle mais aucun de ces arômes n’est présent
physiquement dans le breuvage. À l’inverse, lorsqu’un sourcier dit sentir
de l’eau sous la terre, elle est généralement bien présente
et il ne s’agit pas seulement d’une projection de ses attentes. Il suffit de
creuser pour le vérifier. Certains se trompent rarement, y compris sur
la profondeur et le débit.
Je ne nie pas non plus que
certaines préconisation des géobiologues puissent avoir parfois
des effets positifs sur la santé de leurs clients. On change le lit de
place et on est guéri, je caricature à peine. Il ne fait guère
de doute que l’essentiel de ces effets est du type placebo: ils sont bien réels
mais la cause n’en est aucunement dans la physique terrestre. Bref la géobiologie
en dit plus sur l’être humain que sur la Terre.
Ceci dit, il existe de nombreux phénomènes terrestres susceptibles d’influencer les êtres vivants mais qui n’ont rien à voir avec ces hypothétiques réseaux telluriques. Par exemple:
- les courants
telluriques, au sens de la géophysique, de très faibles courants
électriques dans le sol liés à des phénomènes
d’ionisation par le rayonnement solaire dans la haute atmosphère (donc
ils disparaissent complètement la nuit);
- le magnétisme
terrestre;
- l’influence de la
nature du sol et des courants d’eau sur les facteurs précédents…
Ces phénomènes
peuvent agir sur les êtres vivants du fait que les réactions biochimiques
se font entre ions.
Ajoutons en vrac diverses causes
de perturbations dans notre environnement physique: poussières (acariens,
moisissures, fibres de verre ou d’amiante…), émanations toxiques naturelles
(radon) ou non (peintures, colles, solvants…), champs électromagnétiques,
ionisation de l’air, etc.
En plus de la combinaison forme-matériaux-implantation-orientation
d’une maison, tout ça agit sur nous. À chacun de faire avec. En
veillant tout de même à ne pas être obnubilé pas les
seuls aspects nocifs de notre environnement!
À côté des maladies de l’habitant il y a aussi les maladies de la maison dont il faudrait dire quelques mots. Mais je ne me sens pas compétent. Je laisse cela à d’autres pour en revenir à mon sujet: concevoir-construire les arbres et les nuages.